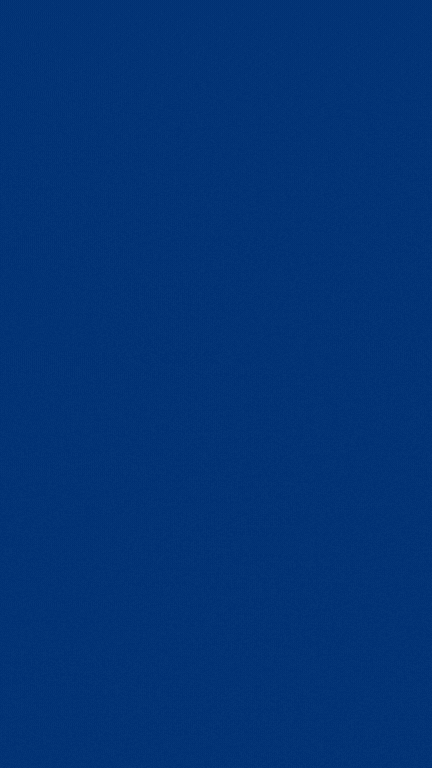Alors que l’Assemblée nationale vient de voter la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE), une autre lecture de cette mesure s’impose. Derrière l’objectif affiché de santé publique, les ZFE pourraient bien s’inscrire dans la continuité d’une politique industrielle discrètement orientée par les intérêts des constructeurs automobiles. Un précédent peut éclairer cette hypothèse : le scandale du Dieselgate.
Et si les Zones à faibles émissions (ZFE), promues au nom de la santé publique, n’étaient que le prolongement d’une politique industrielle maquillée en transition écologique ? Le vote du 28 mai dernier, par lequel l’Assemblée nationale a adopté un amendement pour supprimer les ZFE (98 voix pour, 51 contre), offre une occasion de relire l’Histoire récente de la politique automobile française à la lumière du scandale du Dieselgate.
Officiellement, les ZFE devaient restreindre l’accès aux centres urbains aux véhicules les plus polluants, au nom de la lutte contre la pollution de l’air, responsable de 40 000 décès prématurés par an selon Santé publique France. Mais dans les faits, elles imposent à des millions de ménages le remplacement anticipé de leur véhicule, souvent sans moyens pour le faire. Près de 3 millions de voitures sont concernées, essentiellement des Crit’Air 4, 5 ou non classées, détenues majoritairement par les classes populaires.
Pour La France insoumise, qui s’est opposée dès 2019 à la mise en place des ZFE, le dispositif pénalise les plus modestes sans offrir d’alternative crédible en transports publics. Derrière cette embrouille écologique, on pourrait y voir un mécanisme de relance déguisé : une politique incitative à la consommation, soutenue par une fiscalité biaisée et des intérêts industriels puissants. Cette mécanique n’est pas nouvelle.
Dieselgate, ou comment l’industrie a dicté la norme
Le précédent est connu : en 2015, le scandale du Dieselgate éclate et révèle que Volkswagen, comme d’autres constructeurs, ont délibérément truqué les résultats de leurs moteurs pour passer les tests d’émissions.
« Pas cool » diront certains, « carrément meurtrier » serait l’expression la plus juste. Pendant des années, des millions de véhicules circulent avec des niveaux réels de pollution bien supérieurs aux seuils légaux. L’affaire a mis à jour un système dans lequel les industriels ont orienté les politiques publiques tout en entretenant l’illusion d’un progrès environnemental. En 2012 dans un document de synthèse, sur les Émissions de CO₂ des véhicules pour les particuliers, produit par l’ADEME ( Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), il est écrit : « les moteurs diesel émettent environ 15 % de moins de CO₂ que les moteurs essence équivalents. » C’était oublier les émissions d’oxydes d’azote (NOₓ).
Maladies respiratoires graves
En France, le diesel a longtemps bénéficié d’une fiscalité avantageuse. Jusqu’en 2015, il était environ 15 à 20 centimes moins taxé que l’essence. Officiellement, ce choix reposait sur une meilleure performance du diesel en termes d’émissions de CO₂, un critère dominant dans les politiques climatiques depuis les années 1990.
Mais cette orientation, soutenue par les pouvoirs publics, était aussi activement défendue par les constructeurs français, PSA en tête, largement engagés dans cette technologie du diesel. La mission d’information parlementaire de 2019 sur l’offre automobile l’a reconnu : « la France a délibérément favorisé la motorisation diesel, notamment en raison de son avantage comparatif en matière d’émissions de dioxyde de carbone ». Or, ces gains en CO₂ ont masqué des niveaux élevés d’émissions d’oxydes d’azote (NOₓ), responsables de maladies respiratoires graves, notamment chez les enfants.
Une écologie biaisée au service de l’industrie
Dans ce contexte, les ZFE étaient-elles un nouveau chapitre d’une stratégie déjà bien rodée ? Climat oblige, ces ZFE poussent étrangement au renouvellement du parc automobile, et ciblent les véhicules les plus anciens et non conformes, tout en ouvrant un marché juteux aux constructeurs. Cette politique, perçue comme écologique, agit en réalité comme un accélérateur de consommation, sans remise en question du modèle productiviste.
La suppression des ZFE, votée avec une coalition disparate (RN, droite, LFI, et quelques macronistes), a été dénoncée comme un recul par les collectivités engagées, dont Paris, Lyon ou Montpellier. Mais elle révèle surtout une crise de légitimité : les politiques de transition portées par l’État sont de plus en plus perçues comme déconnectées du réel, imposées sans justice sociale, et trop souvent au service d’intérêts privés.
Alors, derrière l’objectif affiché de santé publique, les Zones à faibles émissions apparaissent comme l’un des outils de mise en conformité de la France face aux injonctions européennes. Depuis 2019, l’État est sous la menace directe de sanctions financières pour non-respect des normes de qualité de l’air fixées par la directive européenne de 2008. Trois condamnations successives du Conseil d’État, dont une assortie d’une astreinte record de 10 millions d’euros par semestre, ont rappelé la responsabilité de l’État à agir, notamment en zone urbaine, où le dioxyde d’azote dépasse encore les seuils admis. En 2023, la facture atteignait déjà 40 millions d’euros.
Déplacer la responsabilité de la pollution sur les individus
C’est dans ce contexte que les ZFE ont été imposées : pour prouver à Bruxelles que des mesures étaient enfin prises. Mais au lieu d’une transformation structurelle des mobilités, avec un investissement massif dans le transport public ou l’accompagnement des territoires dépendants de la voiture, l’État a privilégié une solution rapide, calibrée pour satisfaire les exigences de l’Union européenne tout en évitant de taxer frontalement les grands émetteurs industriels.
Trop fortes, les ZFE ont permis de déplacer la responsabilité de la pollution sur les individus. Une forme d’écologie descendante, coercitive, qui nie les inégalités sociales de la mobilité. Et ce, tout en créant une opportunité de relance pour l’industrie automobile, invitée à écouler des modèles neufs estampillés Crit’Air 1 ou hybrides.
Ce mécanisme, déjà à l’œuvre dans la politique fiscale en faveur du diesel au nom du climat, s’inscrit dans une logique plus large : concilier l’image de la vertu environnementale avec les intérêts économiques dominants, quitte à sacrifier la cohérence sociale de la transition.
L’affaire du Dieselgate a montré comment l’Europe avait laissé prospérer des abus massifs sous couvert de baisse des émissions de CO₂. Les ZFE, bien que justifiées par des impératifs sanitaires réels, ont à leur tour servi un agenda hybride, entre mise en conformité réglementaire, communication gouvernementale et stratégie industrielle.