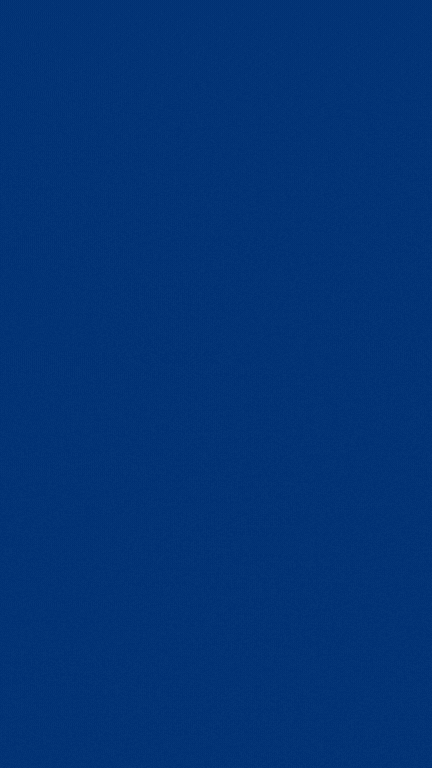Treize ans après avoir échoué à obtenir les 500 signatures requises pour se présenter à l’élection présidentielle de 2012, après avoir multiplié les prises de parole dans les médias à propos de la politique internationale ces dernières années, l’ancien premier ministre de Jacques Chirac Dominique de Villepin officialise son retour en politique avec la création d’un parti, La France Humaniste.
Et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que l’initiative est loin d’être marginale : si on n’imagine pas Jean-Pierre Raffarin ou Jean-Marc Ayrault attirer l’attention de grand monde en créant leur parti, le fait est que cette annonce a en revanche suscité l’intérêt de la presse ; en effet, les sondages indiquent que Dominique de Villepin est étonnamment populaire, de sorte que les médias jouaient depuis un moment déjà à se demander si l’ancien ministre pourrait participer à la prochaine élection présidentielle.
Que signifie ce retour et quelles conséquences peut-il avoir sur la politique française ?
Un parcours privilégié au sein de la diplomatie
Pour comprendre le fonctionnement de Dominique de Villepin, il faut d’abord se rappeler qu’il a longtemps été davantage un haut fonctionnaire, et plus exactement un diplomate, qu’un professionnel de la politique.
Son parcours est emblématique de ce que Pierre Bourdieu appelait « la noblesse d’État » : il vient d’une famille de la bourgeoisie bourguignonne, les Galouzeau de Villepin de leur nom complet, son père a été cadre supérieur puis PDG d’une grande entreprise industrielle avant de se faire élire sénateur RPR, sa mère était magistrate ; il a donc hérité non seulement d’une aisance financière, mais surtout d’un haut niveau d’éducation conforme à la culture reconnue comme légitime dans notre société, à la fois dans son milieu familial et dans un lycée privé catholique. Ce parcours très privilégié, Dominique de Villepin l’a utilisé, après être passé par l’Institut d’Études Politiques de Paris, pour entrer directement à l’École Nationale d’Administration. Il y a rencontré dans sa promotion de futures figures de la vie politique française, notamment Ségolène Royal et François Hollande. Contrairement à eux, Villepin suit la tradition familiale en s’engageant au RPR, le parti héritier de la droite gaulliste. Cependant, qu’ils aillent au PS ou au RPR, les uns et les autres apprennent les idées dominantes à l’ENA en leur temps, qui le sont toujours depuis : l’État doit assurer une régulation de l’économie à distance par la réglementation plutôt que l’avoir sous son contrôle direct ; il faut rembourser les dettes publiques et pour cela, le moyen le plus efficace n’est pas d’augmenter les recettes, mais de réduire les dépenses ; le marché et la négociation interne aux entreprises sont efficients pour assurer le bien-être de la population malgré leurs déséquilibres ; l’État doit être l’affaire des spécialistes formés par l’ENA et les autres grandes écoles, le peuple ne comprend pas les enjeux.
Sous la Vème République, il est devenu courant à l’époque où Villepin commence sa carrière d’avoir ce que le politiste Daniel Gaxie appelle « un parcours politique descendant » : contrairement au parcours de dirigeants politiques qui commencent simples militants, prennent des responsabilités locales puis se font élire à des postes de plus en plus importants jusqu’à devenir des figures politiques nationales, autrement dit le parcours « ascendant » qui dominait les IIIe et IVe Républiques, les énarques qui investissent la politique sous la Vème République commencent par faire une carrière de hauts fonctionnaires au sommet de l’État, collaborant avec les ministres, puis leur parti les envoie se faire élire quelque part pour qu’ils acquièrent une légitimité électorale consacrant la position qu’ils ont déjà prise dans l’État -ils redescendent pour remonter avec l’apparence de la démocratie, en quelque sorte. C’est effectivement ce que font Ségolène Royal et François Hollande, qui ne mettront que quelques années à être candidats à des élections après leur sortie de l’ENA.
Mais pas Villepin : se sentant peut-être une vocation différente, le jeune haut fonctionnaire s’investit avant tout comme diplomate dans les années quatre-vingt, en particulier auprès de l’Afrique et de Madagascar. Il se lance dans cette carrière à une époque où la diplomatie française est consciente de ne plus pouvoir réussir par la seule force en Afrique et dans l’Océan indien, où elle cherche aussi à se montrer comme force de coopération dans le cadre de la Francophonie, d’accompagnement des processus de démocratisation (dont beaucoup ont cependant mal fini), enfin où elle garde une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. De toute évidence, cette expérience a considérablement marqué son parcours ultérieur. Lorsqu’il s’investit aux côtés de figures politiques, c’est en tant qu’expert de l’administration des affaires étrangères : il est directeur de cabinet d’Alain Juppé lorsque celui-ci est ministre des Affaires étrangères, mais ne sera pas candidat à une élection ensuite.
De l’Élysée à Matignon sans passer par les élections
C’est donc par la voie administrative que Villepin arrive… à l’Élysée : vainqueur de l’élection présidentielle de 1995 à laquelle il a vaincu à la surprise générale son rival au sein du RPR Édouard Balladur, Jacques Chirac choisit l’ancien diplomate comme secrétaire général de l’Élysée ; c’est donc lui qui sert d’interface entre le Président de la République et les différentes administrations. Villepin, en effet, lui a été fidèle dans sa lutte contre Balladur, et Jacques Chirac le connaît depuis longtemps, car le diplomate rédigeait pour lui des notes de synthèse sur la politique étrangère dès le début des années quatre-vingt. Mais le septennat de Jacques Chirac prend rapidement l’eau : celui-ci a gagné contre Balladur au premier tout en promettant de réparer la « fracture sociale » avant de l’emporter contre un Lionel Jospin peu combatif au second tour ; une fois au pouvoir, en revanche, lorsque le nouveau Premier ministre Alain Juppé se lance dans une offensive contre la Sécurité sociale, il provoque un mouvement de grève massif qui fait s’effondrer la popularité de l’exécutif, d’autant que la France reste durablement gangrenée par le chômage. Le RPR craint alors de perdre les législatives de mi-mandat en 1998 -il n’existe plus d’élections législatives de mi-mandat de nos jours, suite à la réforme du quinquennat. Pour parer le péril, Villepin propose en 1997 à Chirac de ne pas attendre 1998, de dissoudre immédiatement l’Assemblée nationale pour prendre de court l’opposition, dont il pense qu’elle n’aura pas le temps de s’organiser pour faire campagne. Pari perdu : Villepin, toujours haut fonctionnaire, a mal compris les règles du jeu politique ; sous l’effet de la foudre s’unit une « gauche plurielle » qui met Jacques Chirac en cohabitation avec Lionel Jospin à Matignon. Toute ressemblance avec la situation créée par un autre énarque à l’Élysée l’année dernière est évidemment purement fortuite, mais en ce temps-là, il ne paraissait pas pensable de nommer un Premier ministre qui ne soit pas du même bord que les vainqueurs des élections législatives…
Quoi qu’il en soit, c’est lorsque Jacques Chirac retrouve véritablement le pouvoir en 2002 que Villepin commence véritablement sa carrière politique, puisque Chirac le nomme directement ministre des Affaires étrangères ; un ministère régalien sans jamais avoir été élu de sa vie, c’est alors du jamais vu ! Toutefois, Villepin y acquiert un charisme qui ne l’a jamais quitté depuis : celui d’être l’homme qui a prononcé à l’ONU le discours vibrant par lequel la France s’est opposée à la guerre d’Irak. Tant pis si les contrats pétroliers avec Saddam Hussein y étaient probablement pour davantage que le pacifisme ! Cela confère à Villepin une image suffisamment positive pour qu’en 2005, après un passage au ministère de l’Intérieur, Chirac le nomme même Premier ministre, toujours sans qu’il ait jamais été élu, en remplacement de l’impopulaire Jean-Pierre Raffarin ; son rival Nicolas Sarkozy, l’ancien ministre de l’Intérieur, suscite une popularité encore plus grande dans une part importante de l’électorat de droite par ses discours énergiques en réaction à tous les faits divers qui lui tombent sous la main, mais il est aussi plus clivant et surtout, il avait trahi Chirac pour Balladur en 1995, ce dont le Président de la République lui tenait toujours rigueur.
Comme on le sait, la carrière politique de Villepin à cette époque finit dans l’abîme. Il a pourtant fidèlement gardé cette ligne d’indépendance de la France dans les affaires étrangères, indépendance intéressée aux affaires des capitalistes français, mais indépendance tout de même, et son bilan économique final est plutôt flatteur, même si c’est surtout dû au contexte mondial d’expansion des marchés avant la crise de 2008. Toutefois, il a défendu bec et ongles une mesure néolibérale de précarisation des jeunes travailleurs d’une violence jusque-là inédite, le Contrat Première Embauche, dressant contre lui un gigantesque mouvement social ; non seulement la gauche lui en veut pour cela, mais l’électorat de droite lui en veut aussi, car à la fin des fins, Chirac et lui ont fini par céder… Plus décisif encore : pendant tout ce temps, Villepin n’a aucunement cherché à se construire des soutiens dans l’appareil de l’UMP, le parti qui succède au RPR, puisque la formation de droite issue du gaullisme change régulièrement de nom après avoir cumulé des affaires judiciaires, contrairement à Sarkozy qui a présidé le parti. Il est resté un haut fonctionnaire dans sa tête. Il a cru, aussi, que son charisme le dispensait de disposer d’un appareil politique capable de le relayer dans le pays. Lorsque Chirac quitte la vie politique, Villepin se retrouve donc totalement isolé ; l’UMP envoie naturellement Sarkozy à l’élection présidentielle, qu’il remporte contre une ancienne condisciple de Villepin, Ségolène Royal.
Plus grave encore, Villepin se voit menacé judiciairement : on l’accuse d’avoir délibérément ordonné la poursuite de l’enquête sur les fraudes fiscales de l’affaire Clearstream lorsqu’il était ministre de l’Intérieur parce que Nicolas Sarkozy y était cité alors même qu’il savait que le document était faux, dans le but de torpiller son rival… La justice finit par l’innocenter, mais cela ne sauve pas sa carrière politique. Il tente de se présenter à l’élection présidentielle 2012, profitant du fait que Nicolas Sarkozy est très contesté pour le saccage des services publics auxquels il s’est livré et ne pas avoir su remédier aux calamités économiques qui s’abattent sur la France après la crise de 2008 ; pour ce faire, il axe son programme sur l’indépendance de la France et fait même des propositions étonnamment à gauche puisqu’il propose de hausser le SMIC à 1700€ brut, proposition que défend également le Front de Gauche conduit par Jean-Luc Mélenchon ! Mais sa campagne ne fera pas long feu : sans appareil sérieux derrière lui, ressurgissant de nulle part, Villepin n’obtient pas les 500 parrainages pour se présenter à l’élection.
Jusqu’à la semaine dernière, c’était la fin de sa carrière politique.
Un spécialiste des affaires étrangères critique de l’atlantisme
Pendant les treize années qui se sont ensuite écoulées, Villepin a surtout fait des affaires : mettant à profit son expérience de diplomate et d’ancien ministre, il a fondé un cabinet de conseil en relations internationales, dont les clients sont tenus confidentiels ; cela lui a réussi puisqu’il semble s’être énormément enrichi dans cette période, lui qui venait déjà d’un milieu très privilégié. Toutefois, il a aussi souvent été invité par les médias pour parler de politique étrangère. Très vite, dès le quinquennat de François Hollande, ses points de vue nuancés dans une France où la classe politique est devenue presque totalement alignée sur les États-Unis à partir du retour dans le commandement intégré de l’OTAN décidé par Nicolas Sarkozy lui valent les éloges de gens de gauche, notamment à propos du conflit israélo-palestinien. Il met en outre en avant la diplomatie plutôt que le tout-intervention militaire qui devient dominant dans les rapports des pays occidentaux avec les pays du sud. Tout cela s’est emballé à partir de l’invasion de l’Ukraine par la Russie puis de l’entreprise d’extermination massive dans laquelle s’est lancé le régime israélien suite aux attentats du sept octobre. En passant, Villepin commente aussi l’actualité politique nationale, dans laquelle il se comporte comme une sorte de soutien très critique de Macron, auquel il reproche de bien trop cliver la France.
Les relais médiatiques de Villepin en tant qu’expert de la politique étrangère vont si loin qu’il est même publié par… Le Monde diplomatique : le journal dirigé par Serge Halimi, d’une gauche qui a en particulier été proche de Pierre Bourdieu, lui donne l’occasion d’écrire un long article où il expose sa vision d’une France indépendante agissant pour la paix et le développement. S’il fait évidemment l’impasse sur les rapports d’exploitation de classe internationaux qui sous-tendent en grande partie la politique étrangère, que l’on trouve chez des penseurs néomarxistes comme Immanuel Wallerstein, l’analyse à laquelle il se livre n’en a pas moins un niveau d’approfondissement et de cohérence remarquables.
Dans une France où, en dépit des discours politiques dominants, on a de plus en plus peur de voir une troisième guerre mondiale, où l’on a quand même conscience que quelque chose de grave se passe en Palestine quelle que soit la détestation que l’on ait du Hamas, et où l’on a vécu une crise gravissime du fait de la destruction de l’hôpital public poursuivie sous Macron, mais où l’on a quand même encore un peu peur « des extrêmes », tout cela fait de Villepin une figure non seulement peu clivante, mais même populaire, qui dit des choses qui semblent justes et en décalage avec le reste de l’échiquier politique.
Voilà comment on en est arrivé à cette interview au « Parisien » où Dominique de Villepin annonce la création d’un parti et semble bien avoir l’élection présidentielle en ligne de mire.
Quel potentiel politique pour une droite modérée et non-alignée ?
Et maintenant ? Pour ce qui est du fond politique, Villepin semble n’avoir changé ni en bien ni en mal : il continue de croire qu’on peut et qu’on doit rembourser les dettes publiques en réduisant les dépenses, il dénonce les politiques d’investissement dans l’économie et de reconstruction des services publics financées par l’imposition des grandes fortunes que prône la France Insoumise comme « extrémisme budgétaire » ; il veut faire de sa priorité la reconquête d’une souveraineté « politique, industrielle et technologique de la France », objectif louable et rassembleur, mais pour ce qui est du volet économique, qui détermine tout de même fortement le volet politique, on voit mal comment ce serait possible sans investissement massif de l’État, sinon nationalisation de certains secteurs… Quant à sa communication, il se présente comme le candidat du retour à la modération et du refus de la surenchère médiatique, contre quelqu’un comme Bruno Retailleau, venu de l’extrême-droite catholique et monarchiste du MPF avant d’arriver à LR (c’est-à-dire l’ex-UMP et ex-RPR).
On a beaucoup mis en avant le fait que la popularité de Villepin risquait de ne pas lui être si utile qu’il n’y paraissait s’il revenait en politique. Cela n’a pas grand intérêt d’être populaire auprès de l’électorat de gauche lorsque la gauche a déjà ses champions ; ce qui rend Dominique de Villepin apprécié en particulier des électeurs de la France Insoumise, c’est que ceux-ci retrouvent chez lui des analyses que font aussi leurs propres leaders. Villepin risque donc de se retrouver dans la position symétrique de Fabien Roussel et Arnaud Montebourg en 2022, qui se sont rendus populaires auprès de l’électorat de droite en prenant des positions conservatrices en matière culturelle et parfois même économique, sans pour autant que les électeurs de droite ne préfèrent voter pour eux plutôt que pour leurs partis habituels. Il reste en revanche à Villepin la possibilité de capter un électorat de droite modéré, nostalgique d’avant les outrances de Sarkozy et La Manif Pour Tous : après tout, c’est en partie ce qu’a fait Macron en 2017, de sorte que cet électorat existe probablement encore. Mais préférera-t-il Villepin au camp qui existe actuellement autour de Macron, beaucoup plus structuré et avec davantage de relais ?
La question se pose d’autant plus du fait que Villepin met en avant sa volonté de ne pas brusquer pour mener des réformes économiques. On peut concevoir une politique favorable à la bourgeoisie de façon modérée, préservant des conquêtes sociales voire accordant quelques compromis aux travailleurs à côté d’un soutien qui va avant tout à l’accumulation entre les mains de la bourgeoisie, lorsque la production croît suffisamment pour donner à chacun sa part du gâteau. Mais est-ce le cas dans le contexte économique actuel ? Probablement pas. L’inflation ralentit, certes, mais pas les fermetures et baisses d’activités des entreprises, qui subissent le contrecoup de la fin des aides publiques. La conquête de nouveaux marchés ne semble pas à l’horizon pour la bourgeoisie française, encore moins si la politique protectionniste de l’administration Trump aux États-Unis déclenche un ralentissement des échanges à l’échelle mondiale. Dans ces conditions, il est logique qu’elle veuille continuer à augmenter le niveau d’exploitation des travailleurs salariés, comme l’a récemment encore défendu Édouard Philippe ; et si elle craint que le mouvement social ne l’en empêche, elle préférera faire appel à l’arbitrage autoritaire de l’État à la manière bonapartiste, qu’incarnent le RN et Bruno Retailleau à la tête de LR. Le contexte n’est plus celui de l’élection de Macron en 2017, qui était celui du redémarrage de l’économie après la crise de 2008-2016. Villepin risque donc d’apparaître comme un candidat peu crédible dans cette situation, pour la bourgeoisie, ses médias et les catégories sociales les plus enclines à son influence, notamment les retraités qui votent plus massivement qu’aucune tranche d’âge.
Le retour de Dominique de Villepin confirme par ailleurs une nouvelle fois la forme prise par la vie politique française : La France Humaniste est une organisation à laquelle on peut adhérer sans verser de cotisation, par simple signature sur une plate-forme internet, sur le modèle de la France Insoumise ; la vie politique française continue donc à se réorganiser autour de partis-plates-formes constitués autour de leaders charismatiques, dont les militants sont libres de s’organiser comme ils veulent à leur échelle, mais ne possèdent en revanche pas de pouvoir sur l’organisation nationale, actant une séparation plus forte que jamais entre les producteurs de l’offre politique et des citoyens qui ne peuvent que choisir laquelle ils veulent défendre sur un marché.
Que la tentative de Villepin fonctionne ou non, sa popularité aussi bien que la forme qu’elle prend attestent en tout cas d’une puissante déconnexion entre le monde politico-médiatique d’une part et les attentes des citoyennes et citoyens de l’autre.