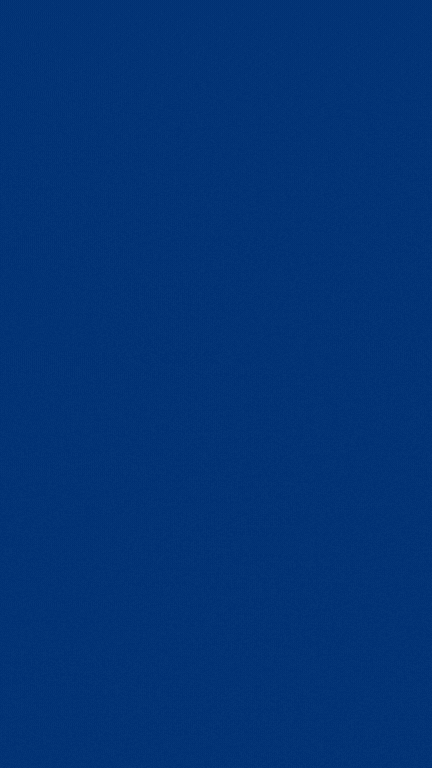Si cela a assez peu filtré des Amfis (université d’été de La France Insoumise) qui ont eu lieu du 21 au 24 août 2025, l’écologie a fait pourtant l’objet de très nombreuses conférences, formations et entretiens et a imprégné la quasi-totalité des débats. Au point qu’à la lecture du programme, on pourrait presque croire qu’on était à l’université des écologistes ! Coups d’œil sur le programme et coups de zoom sur deux débats pour nourrir la réflexion.
» Pesticides, alimentation, environnement : l’ère des maladies politiques ? » avec Mathilde Panot et Sandrine Rousseau, Denis Benoit et Sylvie Poulain du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest, Lucien Mercier, fondateur de Karayib Rassemblement fut le premier « grand débat » écolo des Amfis, suivis de bien d’autres.
Foisonnement de thèmes et d’intervenant·es
Compte tenu des échéances électorales à venir, l’écologie a été amplement abordée sous l’angle municipal : « Quel rôle des communes dans la planification écologique ?» avec Aude Allard, maîtresse de conférence en droit, spécialiste de la planification environnementale, Manon D., militante écologique autrice de L’écologie populaire et Berenger Cernon, député LFI-NFP; « Quel rôle des communes dans la bifurcation alimentaire et agricole ?» avec Eric Gautier, membre de l’association Au maquis, Jeanne Pahun, sociologue spécialiste des politiques publiques alimentaires, Cécile Gazo, sociologue spécialiste de l’installation des agriculteur·trices et Arash Saeidi, député européen LFI; « Adapter nos villes aux changements climatiques » avec Patricia Crosson, conseillère municipale LFI à St Paul (La Réunion), Frédéric Gilli, économiste et co-auteur de La France en perspectives. Imaginer 2050, Diane Strauss, directrice de l’ONG Transport et Environnement, membre du Haut Conseil pour le climat et enfin Sylvain Carrière, député LFI-NFP de l’Hérault.
Du local au global avec : « Écologie et communisme : face aux impasses du capitalisme, le communisme au service de notre programme » avec Catherine Couturier, ancienne députée LFI de la Creuse, Pierrick Monnet, co-animateur du groupe thématique agriculture et Bérenger Cernon, député LFI-NFP; « Guerre commerciale, changement climatique : la France a-t-elle les moyens d’un budget à la hauteur ? », le grand entretien avec Eric Coquerel, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale et François Ecalle, ancien rapporteur général à la Cour des comptes, président de l’association Fipeco ; « Droit à l’eau , droit à l’eau et à l’assainissement de qualité » avec Victor David, chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le développement, spécialiste en droit de l’environnement, du développement durable et du concept de personnification de la nature, Julie Trottier, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’eau en Palestine et Gabriel Amard, député LFI-NFP rapporteur spécial au droit à l’eau et à l’assainissement de qualité; « Impact écologique du numérique et de l’IA » avec Bastien Le Querrec, juriste à la Quadrature du Net, le collectif Le nuage était sous nos pieds et Arnaud Le Gall, député LFI-NFP; « Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ? » grand entretien avec Cédric Durand, économiste auteur de Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète et Claire Lejeune, députée LFI-NFP; mais encore « Comment relocaliser l’industrie de la bifurcation énergétique ? »
Pas directement écologiques, mais en lien étroit avec les enjeux environnementaux : « Drill, baby drill, l’extractivisme au cœur des conflits », « La fonction publique : dernier rempart face à la marchandisation de nos biens communs » avec Arnaud Bontemps, fondateur du collectif Nos services publics, Willy Pelletier, co-auteur de La haine des fonctionnaires et Mathilde Feld, député LFI-NFP;« Accord UE-Mercosur, guerre commerciale de Trump : pour en finir avec le libre échange » avec l’économiste Maxime Combes, Nicolas Girod, éleveur ex-porte-parole de la confédération paysanne et Manon Aubry, co-présidente du groupe de la Gauche au Parlement européen… Dense programme donc proposé aux 5 000 participant·es de ces Amfis 2025. Impossible bien sûr à couvrir et à restituer. Nous en retiendrons deux.
Le concept de « maladies politiques »
Dès le 1er jour, amphithéâtre plein et tonnerre d’applaudissements pour les députées insoumise Mathilde Panot et écologiste Sandrine Rousseau, manifestement touchée par l’accueil chaleureux qui lui est réservé, pour aborder la question des pesticides, de l’alimentation et de l’environnement.
Définissant comme « maladies politiques » des maladies dont la survenue et le développement découlent de choix politiques, l’une comme l’autre ont disséqué la loi Duplomb, dite « loi pesticide » et le contexte dans lequel elle avait été adoptée sans aucun débat, et malgré une opposition inédite du monde médical et scientifique. Comme si cela ne suffisait pas, est venue juste après l’annonce du « pire projet de budget de la 5e république » selon Mathilde Panot, qui prévoit entre autres mauvais coups le déremboursement des médicaments et des économies sur les ALD (affections longue durée). Autrement dit, souligne la présidente du groupe LFI-NFP à l’Assemblée nationale, « non seulement la société vous rend malade, mais en plus de ça, derrière, c’est vous qui allez payer ». Heureusement, il y a eu un signal extrêmement fort avec, en quelques jours, plus de 2 millions de signatures à la pétition contre la loi Duplomb. « Grâce à cette mobilisation citoyenne extraordinaire, nous avons gagné une première victoire avec la censure par le Conseil constitutionnel de l’article autorisant la réintroduction de l’acétamipride». Mais il y a beaucoup « d’autres horreurs dans la loi Duplomb », et c’est pourquoi elle annonce la volonté de l’abroger par tous les moyens.
Sandrine Rousseau a confirmé : « C’est une loi de l’agrobusiness. C’est une loi de la rentabilité. C’est une loi du profit, mais c’est aussi une loi de la maladie des agriculteurs. C’est aussi une loi de la souffrance des agriculteurs. Parce que c’est une loi, qui les enferme dans un modèle d’agrobusiness et de rentabilité à tout craint ». Elle a ensuite pointé la réalité de ces « maladies politiques » : « La France possède des tristes de record en matière de cancer. Nous sommes le pays au monde au monde où il y a le plus de cancers du sein en proportion de la population. Il y a des départements comme les départements ultramarins qui possèdent le record mondial de cancer du pancréas. Et celui de la prostate ? Il a doublé ». Alors que le scorbut refait son apparition en France comme l’a rappelé Mathilde Panot, Sandrine Rousseau termine ce sinistre inventaire par le taux de mortalité infantile (morts des enfants de moins de 1 an) qui place la France l’avant dernière de la classe en Europe. Si ces données sont constamment renvoyées à des comportements individuels, Sandrine Rousseau donne quelques exemples des responsabilités des gouvernements successifs dans cette situation : est-ce un hasard si la mortalité infantile est la plus importante dans le Lot, département où 13 maternités sur 15 ont été fermées ? « C’est le résultat direct d’une politique libérale qui consiste à saborder minutieusement tous les services publics et l’hôpital en particulier. Ces morts-là, ces cancers là, sont politiques » .
Quand la violence sociale se retourne contre soi-même : santé mentale en danger
Avec gravité, Sandrine Rousseau aborde un autre aspect « de nos maladies qui sont elles aussi politiques : C’est notre santé mentale » dont on parle peu, mais qui constitue selon elle « une épidémie en France ». Elle relève un seul chiffre, « qui devrait faire la Une de tous les journaux » : le taux d’hospitalisation des jeunes filles de 10 à 19 ans pour tentative de suicide en augmentation de 570% depuis 2007. « Aujourd’hui, en France, un médecin scolaire sur deux manque à l’appel » tandis que les psychologues dans les collèges et les lycées ont pour principale mission de favoriser l’accès à l’emploi et non d’assurer la santé mentale. Plus généralement, la psychiatrie en France est en état d’effondrement. « Les infirmiers et infirmières en psychiatrie démissionnent. Les psychiatres tiennent l’hôpital public à bout de bras ». Et en fait « toute la violence sociale, toute la précarisation, toute la violence des réseaux sociaux, tout le libéralisme économique, mais aussi cette non-régulation par exemple des réseaux sociaux, tout ça a un impact sur notre santé. Beaucoup retournent cette violence contre eux-mêmes».
Revenant sur le projet de budget Bayrou et l’intention de s’en prendre aux arrêts maladie longue durée, elle constate « C’est sur les plus vulnérables encore une fois qu’on va aller taper. Alors je ne vais pas être longue pour vous dire qu’il n’y a pas 36 solutions pour arrêter ça, pour arrêter cet effondrement de notre santé, c’est que nous arrivions au pouvoir. »
Les représentant·es du collectif de soutien aux victimes des pesticides ont décrit les longues batailles qu’il a fallu mener pour obtenir la reconnaissance des cancers et maladie de parkinson en maladies professionnelles pour les agriculteur·trices victimes des pesticides, mais aussi pour la prise en charge et l’indemnisation des riverains et leurs enfants malades des épandages.
Représentant de Karayib Mouvement, Lucien Mercier a raconté la chronologie du scandale du chlordécone imposé aux Antilles à partir des années soixante et son inscription dans une histoire coloniale qui n’est pas close. Héritiers des esclavagistes d’hier, les grands propriétaires « békés » responsables de l’empoisonnement pour 7 siècles des terres et des eaux des Antilles ont jusqu’à aujourd’hui obtenu l’impunité. Seule avancée arrachée dans ces décennies de luttes : le dépistage gratuit. « Tout le monde sait, tout le monde savait, conclut Mathilde Panot, mais le choix a été fait sciemment de nous empoisonner et d’effacer les traces. »
Il faut sortir du citoyen-électeur qui « veut de l’écologie » pour aller vers des travailleurs qui produisent écologiquement
Vendredi sous un chapiteau, le débat « Écologie & communisme » a porté sur les bases de la planification écologique, à partir d’exemples d’emblée très concrets. L’ancienne députée LFI de la Creuse, Catherine Couturier (dont la permanence a été cinq fois attaquée par la Coordination Rurale) a faire part de son combat parlementaire visant à soustraire la gestion des territoires des logiques capitalistes, à partir de la proposition de loi relative à l’adaptation de la politique forestière face au changement climatique. Cette loi n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour. Pourtant, l’ampleur des incendies cet été et leur apparition dans des régions jusqu’ici épargnées, l’insuffisance des moyens d’intervention ( les fameux Canadairs manquants) montrent l’urgence à changer radicalement de modèle d’exploitation et à cesser de dépouiller les services publics. Mais comme pour les maladies évoquées la veille, Catherine Couturier constate qu’« au lieu de se demander pourquoi de tels incendies ont pu ravager tant d’hectares, le pouvoir s’est demandé qui a mis le feu. »
Dans une vision écologique de la production respectant la qualité alimentaire et les ressources, il faudrait, selon Pierrick Monnet, à minima doubler le nombre d’agriculteur·trices (400 000 actuels, nombre qui ne cesse de se réduire) alors que les besoins sont estimés par la Confédération paysanne à 1 million, et à 2 millions pour l’organisation de développement agricole. « On ne les a pas, on n’aura jamais assez d’enfants pour les avoir, si tenté que tous les enfants de paysans veuillent le devenir, ce qui n’est pas le cas ». La solution ? Certes assurer des revenus décents, mais surtout « créer un désir de devenir agriculteurs« , nécessairement plus nombreux si on veut développer l’agriculture biologique, et puis créer une « envie de travailler dans tous les métiers concourant à la transition écologique : la rénovation énergétique, les vêtements produits autrement, la saine exploitation des forêts avec davantage de bûcherons et de gens qui savent travailler le bois… » la liste est longue. Que ce soit au niveau agricole ou artisanal, il faut que l’activité qu’on exerce donne du sens et de la satisfaction.
Pour ce jeune agriculteur, « l’enjeu du capitalisme, c’est de dominer le travail pour en tirer le maximum de profit. C’est à nous travailleur de reprendre la main au quotidien sur « comment on produit, qu’est-ce qu’on produit et pour qui ? « . C’est la grande question ». Et puis il pense qu’il faut aussi savoir dire non à la destruction des ressources naturelles, quelles qu’en soient les formes. Il faut inciter les gens à utiliser leurs compétences pour concevoir et produire autrement. Pierrick Monnet part du postulat que « si les travailleurs changent leur mode de production, les consommateurs suivront ».
Maîtrise du foncier et expérimentation d’autres formes de gestion
Rappelant qu’il n’y a que 6 ouvriers sur 577 députés, le seul cheminot à l’Assemblée nationale, Berenguer Cernon, affirme que le pouvoir actuel est incapable de penser la question écologique et donc de l’anticiper, pas plus que les industriels évidemment qui jouent les profits à courte vue. Il cite le fiasco des ZFE et la persistance des fermes usines et des méga-bassines dans la loi Duplomb, le poids des lobbys à la tête desquels se trouve la FNSEA.
A été posée aussi dans le débat l’intéressante question du foncier, et plus précisément du statut des terres agricoles ainsi que du mode de gestion des exploitations. Pierrick Monnet a développé les différentes formes coopératives dont le « principe directeur devrait être de ne pas avoir de directeur » précise-t-il avec humour. Il cite également l’existence dans le droit français de la «propriété sectionale », répandue dans le Limousin, mais peu connue ailleurs. De quoi s’agit-il ? Ce sont des bois ou des terres agricoles qui appartiennent à la commune et ne sont pas utilisées. Ce sont alors les gens qui habitent sur cette section inaliénable de territoire qui décident ensemble ce qu’ils en font. C’est une forme de propriété collective. « Ce n’est pas quelqu’un qui est propriétaire et qui habite Paris par exemple et qui décide de raser 40 hectares, ce sont les habitants qui décident de l’usage de ces sections » décrit Pierrick, « C’est une brèche qui pourrait être réutilisée à l’avenir». Cette suggestion a été complétée dans le débat par Catherine Couturier qui plaide pour l’extension du droit de préemption des communes et par différents témoignages sur les expérimentations de sécurité sociale alimentaire adossées à des productions de proximité. Mais bien sûr, cette profusion d’initiatives indispensables pour se défaire des mécanismes capitalistes ne suffit pas à garantir une bifurcation écologique globale. D’où la nécessité d’une planification nationale et de services publics solides pour la mettre en œuvre.
Une planification indispensable pour anticiper et garantir l’avenir
Constatant que le « premier financier de la pollution agricole est le Crédit Agricole« , Pierrick Monnet préconise sa nationalisation pour qu’il ne se contente pas « d’éponger les dettes », mais participe à la transformation écologique de l’agriculture. À l’exemple de cette révision du système bancaire agricole qui pourrait avoir un pouvoir d’orientation, Maxime Bergonso, éleveur en Bretagne, fait remarquer que la planification écologique a besoin d’être portée par des services publics nationaux forts et structurants. Les offices nationaux ou Météo France qui manquent cruellement de moyen, mais aussi la maîtrise totalement publique du nucléaire et des transports. L’illustration la plus évidente est celle de la SNCF, les pays comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne qui avaient abandonné le ferroviaire à la concurrence se retrouvent contraints de renationaliser. Différents témoignages ont montré dans ce domaine les impasses du coopérativisme. Parmi ces services publics, l’éducation n’est pas en reste. L’enseignement agricole demande à être complètement revu, car il promeut des logiques de rendement incompatibles avec le respect des écosystèmes. Les échanges sur les moyens de sortir du modèle du « tout bagnole » dont le coût s’avère exorbitant sont interrompus par les haut-parleurs qui annoncent la fin des débats. Le timing est serré. À suivre.