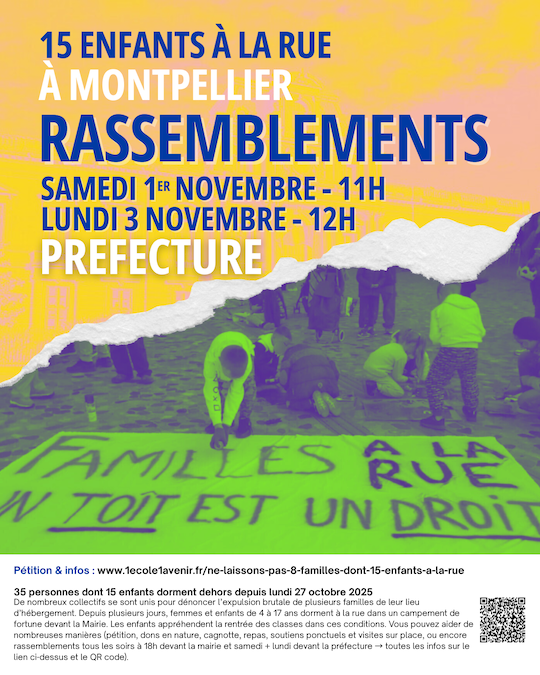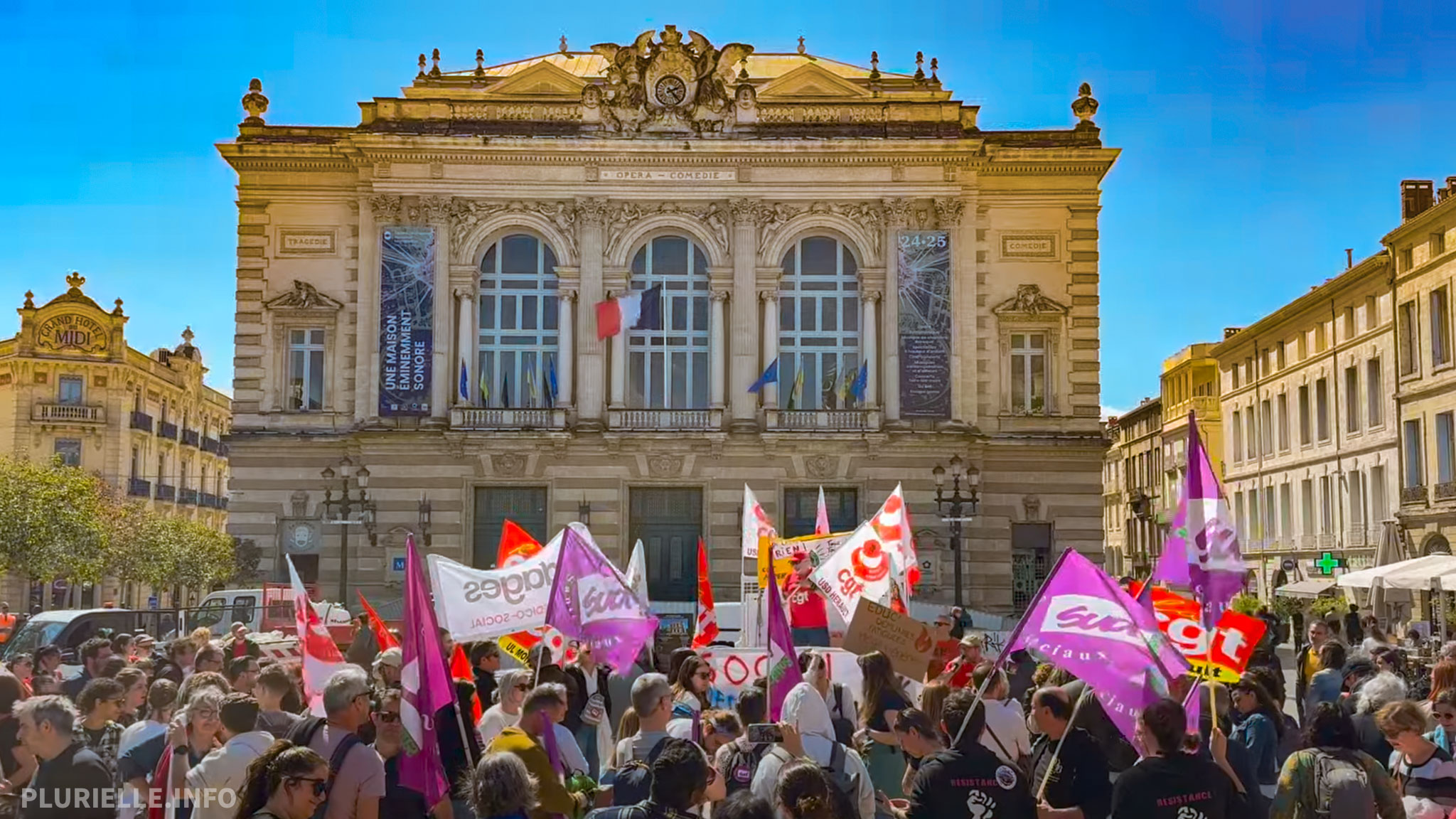Alors que la malbouffe et l’inflation fragilisent toujours plus de foyers, l’idée de créer une sécurité sociale de l’alimentation (SSA) fait son chemin. À l’occasion d’une conférence-débat organisée à Sète le 18 avril par la France Insoumise et animée par Olivier Ravel, Ingénieur de recherche au CNRS, Sylvain Carrière député de l’Hérault et Dominique Paturel, chercheuse SHS, militante du PEPS (Pour une Ecologie Populaire & Sociale) ont présenté l’esprit de cette proposition audacieuse dans une vision transformatrice du “droit à bien manger”.
Pour le député, ce qui est à l’ordre du jour avec la SSA, c’est de conquérir un nouveau droit, au même niveau que la Sécurité sociale en 1945, car la SSA porte l’ambition de garantir un accès universel, durable et démocratique à une alimentation de qualité. Cette proposition de loi déposée par les Écologistes et dont Sylvain Carrière est le chef de file LFI pour la défendre, s’inscrit dans une volonté claire de rupture avec le système actuel fondé d’un côté sur une agriculture industrielle mondialisée et de l’autre sur l’aide alimentaire d’urgence.
Des dynamiques citoyennes pour revoir tout le système
Quand 8 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire -un chiffre qui a triplé depuis 2012 ! – «ce n’est pas d’une politique de charité” dont nous avons besoin, mais “d’un droit» a souligné le député insoumis, dénonçant un modèle agricole incapable de nourrir dignement sa population tout en maintenant un agriculteur sur 5 sous le seuil de pauvreté. Il plaide pour un système fondé sur trois axes : l’universalité de l’accès à une alimentation saine, le financement par cotisation et un conventionnement démocratique piloté par les citoyen·nes. Comme dans les actuelles expérimentations, ce sont elleux mêmes qui décident des produits et des distributeurs agréés par le système.
LIRE AUSSI, ZFE : « On a mis la charrue avant les bœufs » explique Sylvain Carrière
Sylvain Carrière a rappelé que la proposition de loi portée par le groupe écologiste à l’Assemblée avait pour ambition de financer 20 expérimentations locales sur cinq ans, à l’image de la caisse alimentaire de Montpellier qui s’apprête à passer de 350 à 600 bénéficiaires. Mais les député·es, du centre à l’extrême droite, ont empêché son adoption, au nom de son coût jugé excessif. Pourtant, «la malbouffe coûte 19 milliards par an à la collectivité», a-t-il souligné, largement de quoi financer cette expérimentation de la SSA. Rappelons qu’en février 2025, privé de temps, mais pas de voix, Charles Fournier, député Les Écologiste et vice-président de la commission des affaires économiques n’avait eu que 25 minutes à l’Assemblée pour défendre sa proposition de loi sur la Sécurité sociale de l’alimentation. Une fin abrupte pour un texte, mais pas pour une idée qui gagne du terrain.
Les systèmes alimentaires sont des biens communs
Aux côtés de Sylvain Carrière, la chercheuse Dominique Paturel, militante du mouvement PEPS (Pour une écologie populaire et sociale, mouvement d’inspiration communaliste et éco-féministe) considère la question de la SSA, sur laquelle elle travaille depuis plus de 10 ans, comme “centrale dans la façon dont on peut penser les résistances et les luttes sociales “. Elle apporte un éclairage théorique pour clarifier toutes les dimensions d’un projet qui ne se limite pas à l’accès aux « produits alimentaires », mais recouvre tous les systèmes alimentaires qui devraient être reconnus comme “biens communs” parce qu’ils sont vitaux à tout être humain. À ce titre, ils ne devraient pas être “dans l’escarcelle du marché capitaliste” : « Ce que nous portons, c’est une mise en sécurité sociale des systèmes alimentaires dans leur ensemble, pas un nouveau label pour les circuits courts », a-t-elle insisté, évoquant la possibilité de créer pour l’assurer une nouvelle branche de la sécurité sociale, pour éviter toutes tentatives de récupération institutionnelle ou marchande qui voudraient dévoyer les aspects égalitaires et qualitatifs du dispositif. Quant à son financement, actuellement limité dans les expérimentations locales à des subventions et des cotisations volontaires, le choix de l’assiette de cotisations appelées à devenir universelles (sur le revenu de base ou sur la plus-value) est l’objet d’âpres débats.
Un moyen de reprendre la main sur nos systèmes alimentaires
Pour être efficace, la Sécurité sociale de l’alimentation doit concerner toutes les étapes et la possibilité de les discuter localement : la production, la transformation (qui, précise-t-elle, concerne de très nombreuses TPE et artisans), la distribution et la consommation… et même le conditionnement et le traitement des déchets… À cela s’ajoute une dimension internationale : comment relocaliser tout en tenant compte de la dépendance structurelle à des productions externalisées, souvent issues de systèmes néocoloniaux ?
Nombreux·ses intervenant·es insistent sur l’importance des expérimentations et du respect de la diversité des situations, mais aussi de la mémoire des luttes sociales (notamment comment la sécurité sociale a été fragilisée), des nouvelles formes d’organisation qui émergent, des rapports de domination, et la nécessité d’inclure dans les processus décisionnels celleux qui en sont actuellement écartées (les femmes, les enfants, les populations racisées…) .
D’autres pays comme la Belgique, l’Allemagne ou l’Italie expérimentent ce système . La reconnaissance par les états du droit à l’alimentation est de plus en plus portée à l’échelle européenne et même mondiale.
Sortir de 50 ans d’alimentation industrielle
Loin d’un slogan abstrait, la SSA apparaît comme un outil puissant d’élaboration politique et de transformation sociale. Elle permettrait non seulement de répondre à une urgence humanitaire, mais aussi de réconcilier démocratie, écologie, santé publique et justice sociale en s’appuyant sur l’expertise populaire et notamment celle des femmes.
Son adoption et sa mise en œuvre restent un défi ambitieux, car elle met en cause les intérêts de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution défendus par le pouvoir en place. Mais les dynamiques locales, les convergences des expérimentations montrent qu’un autre modèle alimentaire est possible, à condition d’en faire une bataille collective, réellement populaire et non déconnectée de son objectif transformateur.
Pour Dominique Paturel, la SSA ne saurait se construire sans remettre en cause les logiques de domination héritées du colonialisme alimentaire et du capitalisme industriel. Autrement dit, il ne s’agit pas à une « petite bourgeoisie urbaine » éclairée d’expliquer aux pauvres comment bien se nourrir mais de trouver des formes d’organisation locales ancrées dans les territoires, portées par les habitant·es eux-mêmes, loin des modèles technocratiques, pour reconstruire des systèmes sains et solidaires : « Ce projet est une réponse à l’extrême droite, à la dépossession démocratique et au modèle agro-industriel mortifère » car c’est dans l’échange que se construisent les solutions alternatives en capacité de répondre aussi aux risques climatiques qui précarisent et vont bientôt réduire radicalement les ressources agricoles.
Alors que certaines collectivités, comme la ville de Grabels, intègrent déjà ces enjeux dans leur projet municipal, les deux intervenants ont appelé à faire de la SSA un marqueur fort des programmes de gauche pour les prochaines élections municipales. Car plus qu’un levier alimentaire, ce dispositif de redistribution géré par ses bénéficiaires (qui pourrait fort bien intégrer la restauration collective) est un outil d’émancipation humaine.