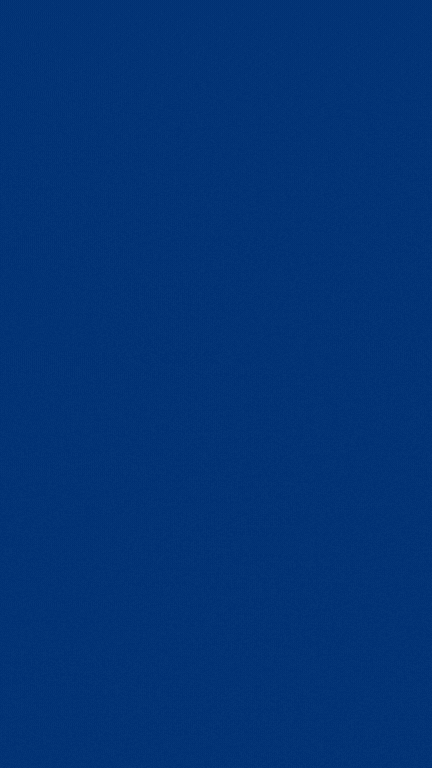Le braquage spectaculaire du Louvre, survenu dimanche 19 octobre au matin, a rapidement quitté le champ judiciaire pour entrer dans l’arène politique.
En quelques heures, les réseaux sociaux des ministres se sont transformés en tribunes sécuritaires, transformant un vol de bijoux historiques en démonstration d’autorité publique.
Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, a parlé d’un acte « d’une gravité extrême » avant même les premières conclusions de l’enquête, évoquant « la nécessité de renforcer la sécurité des lieux culturels ». Rachida Dati, ministre de la Culture, s’est rendue sur place et a publié dès 10 h un message sur X pour affirmer que l’État serait « intraitable face aux atteintes au patrimoine national ».
Communication instantanée
Ce réflexe de communication instantanée, avant toute vérification, a donné au drame un relief politique qui dépasse le cadre du fait divers. Depuis plusieurs semaines, l’exécutif multiplie les déclarations martiales après une série de vols dans des musées français. Mais la réponse institutionnelle pour dire davantage de caméras, des vigiles armés, des budgets d’alarme, nourrit surtout une logique d’émotion et de contrôle.
Instrumentalisé, le cambriolage du Louvre
Les syndicats de la culture, eux, rappellent que les réductions de personnel de surveillance depuis dix ans ont fragilisé les musées nationaux. Instrumentalisé, ce cambriolage du Louvre sert aujourd’hui à justifier un discours d’ordre et de fermeté, alors que l’enquête de la Brigade de répression du banditisme (BRB) vient à peine de commencer. En détournant l’attention avec des éléments de langage sécuritaire, le pouvoir occulte le vrai débat : celui du sous-financement chronique du patrimoine et de la culture publique.