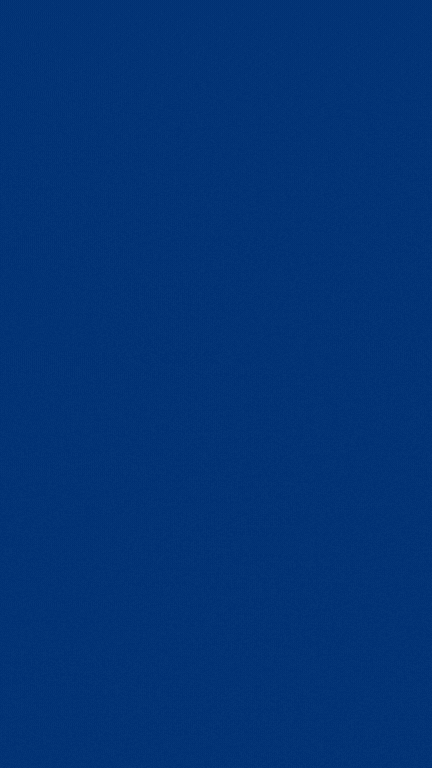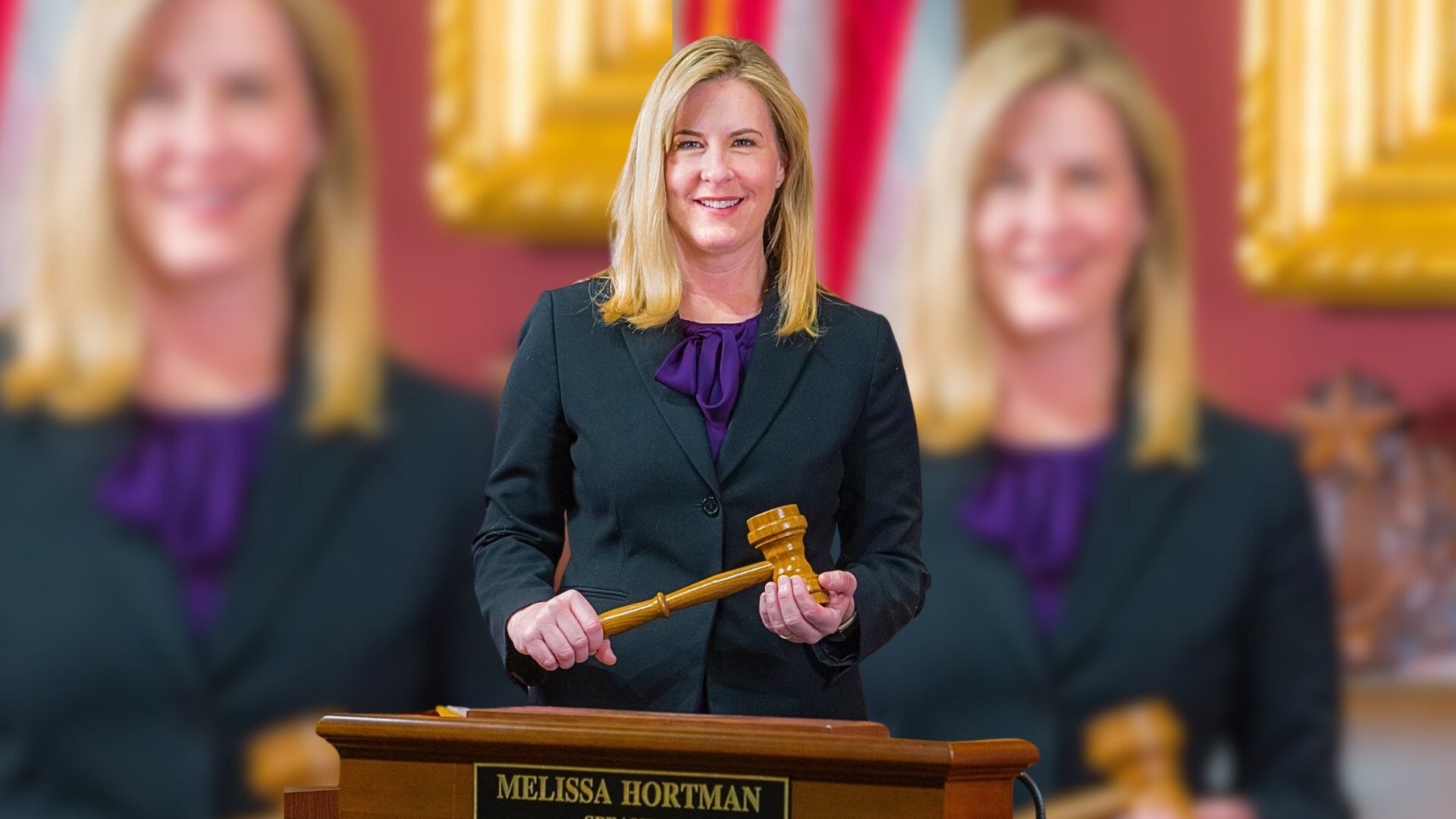Les progrès techniques et les évolutions scientifiques ont transformé la médecine depuis la fin du 20e siècle. Cependant, au fil des avancées, face à une extraordinaire efficacité des techniques de diagnostic et des traitements, la qualité humaine des soins s’est dégradée.
Le patient s’est transformé en client, l’hôpital en entreprise et les questions financières sont devenues prédominantes dans une logique d’efficience de production de soins. Cette situation est douloureusement ressentie par le patient, relégué derrière la maladie et non plus pris en compte comme un individu singulier ayant son histoire et ses particularités.
Le manque de temps est souvent invoqué par les soignants, mais il s’agit d’un argument fallacieux, dans la mesure où ce qui est véritablement en cause n’est pas la durée de la rencontre, mais un manque de dialogue, d’accompagnement et d’empathie.
Problème dans la formation des médecins
Le problème est que la formation des médecins s’est concentrée sur les sciences dites fondamentales dans une vision technicienne et techniciste de la médecine, oubliant que leur rôle est de maintenir chez leurs patients un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Une des causes de cette situation de déshumanisation de la médecine est le déclin de la culture générale. En effet, malgré des évolutions récentes dans les études de médecine avec l’intégration d’enseignement de sciences humaines en début de cursus, la sélection se fait principalement sur les matières scientifiques et une concurrence entre étudiants à l’opposé des valeurs de solidarité, de collaboration et de soutien de ceux qui sont en difficulté. Tout ceci est en contradiction avec l’objectif d’un développement chez les jeunes soignants de capacités d’attention, d’observation, d’étonnement, de curiosité et d’esprit critique.
Vers une médecine humaniste
Mais que signifie aujourd’hui le terme de médecin humaniste ? Cela implique qu’avant de prescrire des actes techniques, il doit regarder, écouter, toucher le patient avec une attitude rassurante faite de tact et d’empathie, incluant la politesse, la diplomatie et la délicatesse. Pour cela, le médecin humaniste doit puiser dans sa culture générale intégrant des éléments de psychologie, de sociologie, d’histoire, d’ethnologie, etc., lui permettant d’entrer dans l’univers du patient dans le but de l’accompagner avec l’objectif du meilleur état de santé possible.
Il est donc indispensable de modifier la formation initiale des futurs médecins. Le préalable doit être de bien préciser aux étudiants que la médecine avant d’être une science est bien un humanisme, ce qui implique la volonté et les capacités de s’y impliquer. Par ailleurs, au-delà d’un enseignement traditionnel des sciences humaines, il y a la nécessité d’un accompagnement culturel tout au long du cursus avec, comme le propose deux membres de l’Académie de médecine, la création dans chaque faculté de médecine d’un département de philosophie et pédagogie de la santé qui serait dirigé par un philosophe universitaire.