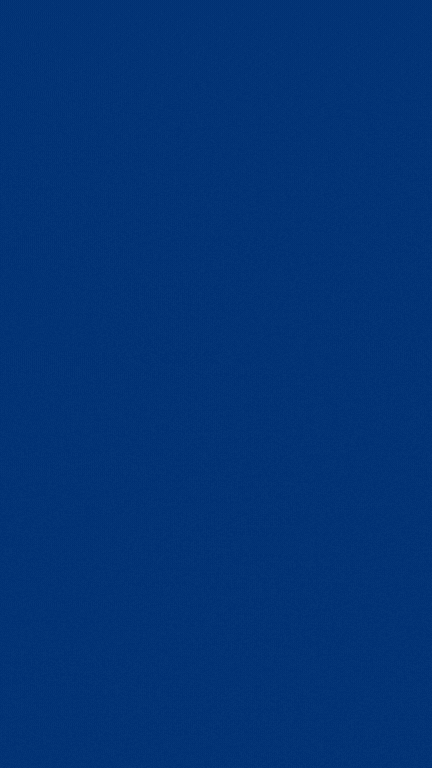Environ 22,79 milliards d’euros, c’est la capitalisation boursière de Véolia, un chiffre qui permet d’évaluer la taille d’une entreprise, et de la classer. Il est un proverbe qui dit que « l’eau n’oublie pas son chemin », c’était oublier celui des marchés financiers qui obéit à un autre proverbe « chacun dirige l’eau vers son moulin. »
Pour La France Insoumise, l’eau est un bien commun qui ne doit en aucun cas être privatisé. Dans le programme L’Avenir en commun, la gestion publique et citoyenne de l’eau, est une priorité qui appelle à rompre avec les délégations de service public au privé (DSP) comme celles confiées à Veolia ou Suez dans de nombreuses communes françaises.
Uchronie : et si Véolia n’existait pas ?
Tentons une belle uchronie pour réfléchir à la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie : et si Véolia n’existait pas ? En l’absence de ce mastodonte privé, les collectivités auraient conservé plus largement la maîtrise de leurs services publics. Moins de délégations, plus de régies locales, et une gouvernance plus transparente. Sans l’influence d’un acteur aussi puissant, les choix politiques auraient pu s’orienter plus tôt vers une gestion publique, démocratique et moins soumise aux logiques de rentabilité, avec des tarifs souvent plus bas, une meilleure lisibilité des coûts. Mais voilà les 22,79 milliards d’euros de capitalisation boursière sont bien réels.
Tour de passe-passe ou de bonneteau du « nouveau Suez »
14 mai 2021, Veolia et Suez signent un accord de fusion après des mois de bras de fer pour 13 milliards d’euros. En juin 2021, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire concernant des soupçons de trafic d’influence liés à cette offre publique d’achat (OPA). Problème : Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, auraient favorisé cette opération. À ce jour, aucun jugement définitif n’a été rendu, mais cette fusion ressemble à un tour de passe-passe ou de bonneteau qui a vu naitre le « nouveau Suez ». Veolia a cédé certaines activités à un consortium d’investisseurs, notamment les branches Eau et Recyclage & Valorisation de Suez en France. Le 31 janvier 2022, un trio d’investisseurs, Meridiam, GIP, CDC est aux commandes de Suez.
Bruno Le Maire avait salué une « victoire française ». Mais derrière ce vernis patriotique, les logiques financières triomphent. Un cours magistral que doit donner l’ancien ministre de l’Économie qui enseigne à Lausanne, en Suisse, depuis septembre 2024.
« L’eau est un bien commun, pas une marchandise ! » René Revol
À Montpellier, la gestion de l’eau est publique depuis 2016 : une régie métropolitaine assure le service sans but lucratif, avec un tarif total moyen d’environ 3,06 € TTC/m³ (1,41 € pour l’eau potable et ~1,65 € pour l’assainissement). À Nîmes, la métropole a confié l’eau à Veolia, depuis janvier 2020, au tarif de 4,0089 € TTC/m³ (2,28 € pour l’eau potable et 1,73 € pour l’assainissement). Soit près d’un euro de plus par m³. Un écart qui reflète deux modèles opposés : à Montpellier, les bénéfices sont réinvestis dans la transition écologique et la maintenance des réseaux ; à Nîmes, ils alimentent en partie les dividendes privés. Bref ! La régie publique montpelliéraine permet davantage de transparence et de contrôle citoyen. Face à la crise climatique et à la raréfaction de la ressource, le modèle montpelliérain fait école, tandis que Nîmes reste ancrée dans une logique de délégation marchande. René Revol président de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole depuis 2016 a réaffirmé le 22 mars 2025 à l’occasion de la journée mondiale de l’eau : « L’eau est un bien commun, pas une marchandise ! C’est le sens de mon action. »
Une vitrine du savoir-faire industriel français et sa chronologie de scandales
Une vitrine qui semble bien sale, pour dire vrai. Les scandales passent et le public oublie, mais les faits restent. Veolia, ce leader mondial de la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie cache une longue liste de scandales en France comme à l’international. Retour sur une histoire marquée par la surfacturation, les pollutions, les ententes illégales et les conflits d’intérêts.
En 1853, est créée sous Napoléon III la Compagnie Générale des Eaux (CGE), qui devient Vivendi en 1998 pour être ensuite baptisée Véolia en 2003. Mais déjà, dans les années 90, des pratiques douteuses apparaissent. En 1995, à Grenoble, un contrat passé avec la CGE pour la gestion de l’eau aboutit à une affaire de corruption. Le maire Alain Carignon sera condamné à 5 ans de prison ferme, suivis de cinq ans d’inéligibilité. La ville mettra fin à la délégation de Veolia.
Dans les années 2000, les critiques sont récurrentes à propos de contrats opaques passés avec les collectivités locales. Plusieurs villes dénoncent une tarification abusive. En 2005, l’UFC-Que Choisir publie une étude révélant que les usagers paient en moyenne 25 à 30 % de plus que si le service était géré en régie publique.
2010, la ville de Paris met fin au contrat de délégation passé avec Veolia et Suez. Un audit révèle que les deux entreprises réalisaient des marges importantes. La remunicipalisation permet une baisse du tarif de l’eau de 8 % dès la première année.
En 2011, l’Autorité de la concurrence sanctionne Veolia et Suez à hauteur de 60 millions d’euros pour entente illégale sur les prix et la répartition du marché de l’eau en Île-de-France. Ce cartel, en place pendant plus de 15 ans, avait un seul objectif : verrouiller le marché au détriment des collectivités locales et des usagers.
Pollution et santé publique : le scandale de Flint
Entre 2014 et 2016, Veolia est impliquée dans le Flint Water Crisis aux États-Unis. La ville de Flint (Michigan) sollicite Veolia pour auditer la qualité de l’eau, suite à des plaintes de résidents sur son goût et sa couleur. Veolia assure que l’eau est conforme. Mais quelques mois plus tard, des analyses indépendantes révèlent une contamination massive au plomb. Cette contamination affecte la santé de milliers de résident·es, notamment des enfants. Une plainte collective est portée contre Veolia pour négligence grave. En février 2025, Veolia a accepté de payer 53 millions de dollars pour régler les poursuites restantes liées à cette affaire, mais en persistant à nier toute responsabilité. Affligeant ? Certes, et ce n’est pas terminé…
Rejets toxiques et incinérateurs
En France, plusieurs incinérateurs exploités par Veolia font l’objet de critiques. En 2022, Reporterre révèle que le site de Claye-Souilly (Seine-et-Marne), une des plus grandes décharges d’Europe, rejetterait des substances toxiques dans la nappe phréatique. Les autorités locales dénoncent un simple manque de surveillance environnementale. En 2023, une enquête conjointe de Disclose et Mediapart montre que plusieurs incinérateurs (dont celui d’Ivry-sur-Seine) ont dépassé les normes d’émissions polluantes, sans que l’information ne soit correctement transmise aux riverains.
Conflits d’intérêts et lobbying
Veolia est régulièrement accusée de lobbying intensif auprès des collectivités pour obtenir ou renouveler des contrats. Plusieurs rapports pointent des connexions politiques et un « revolving door » entre cadres dirigeants de l’entreprise et responsables publics.
Un simple exemple : l’entreprise participe activement à des événements avec des élus locaux. Selon Le Monde, Veolia et d’autres entreprises privées sont au cœur d’événements organisés par des associations d’élus, tels que l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF). Des interactions, qui voudraient tout simplement faciliter le dialogue et partager des expertises, mais suscitent de nombreuses interrogations sur la frontière entre réseautage, lobbying et corruption.
Autre exemple, en 2015, un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l’eau à Marseille notait le caractère très peu concurrentiel des appels d’offres et l’équilibre très favorable fait à Veolia. Les responsables politiques de la ville ont pourtant renouvelé le contrat jusqu’en 2030.
Crises à répétition dans le monde
Crises à répétition : Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, dans de nombreux pays du Sud, Veolia est accusée de ne pas respecter ses engagements contractuels. En Afrique du Sud, sa gestion du service d’eau de Johannesburg provoque des coupures répétées et des manifestations (2017). En Irak, en 2023, la province de Bassorah engage des poursuites pour non-respect des obligations de construction d’une station de traitement. En Argentine, dans les années 2000, l’entreprise quitte le pays après un conflit sur les tarifs avec l’État, laissant derrière elle des infrastructures délaissées.
La fontaine du village devenue marchandise
Où est la fontaine du village qui symbolisait souvent le centre de la vie communautaire, un lieu où les informations étaient échangées et les liens sociaux renforcés. En ouvrant le robinet, aurait-on perdu une part de notre fraternité ?
Antoine Frérot a été le président-directeur général (PDG) de Veolia Environnement de 2009 à 2022. En juillet 2022, il a cédé la direction générale à Estelle Brachlianoff, tout en conservant la présidence du conseil d’administration, ce qui lui permet de continuer à d’influencer la stratégie du groupe. Pour rappel, alors que l’ensemble des PDG des grandes entreprises françaises penchaient en faveur du candidat conservateur François Fillon, tous prêts à lui payer pompes et costumes, Antoine Frérot aurait été l’un des premiers dirigeants du CAC40 à soutenir Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017. Un soutien précoce, pour un investissement gagnant ?
Le sang de la terre
Le 11 octobre 2022, la proposition de loi n° 325 déposée par des députés LFI était présentée pour garantir l’accès à l’eau potable par la gratuité des premiers mètres cubes, jugés vitaux pour l’hygiène et l’alimentation. Portée par Gabriel Amard, avec Bénédicte Taurine, Manon Meunier et Sylvain Carrière, elle a été rejetée en séance publique le 24 novembre 2022, malgré son passage en commission.
Il faudra du temps pour retrouver le son apaisant de l’eau qui coule au cœur de la cité. Pour cela, il est urgent de légiférer, d’agir, de reprendre la main. La remunicipalisation de la gestion de l’eau n’est pas une utopie. Elle a déjà fait ses preuves. C’est une réponse concrète, démocratique et durable face aux dérives du marché. Elle permet de replacer l’humain et l’écosystème au centre, de garantir l’accès à une ressource vitale, de restaurer la confiance et la transparence. La puissance publique doit protéger l’eau, en faire un droit fondamental. L’eau n’est pas une marchandise, « l’eau est le sang de la terre, le support de toute vie », écrivait en 1945 le philosophe autrichien Viktor Schauberger.