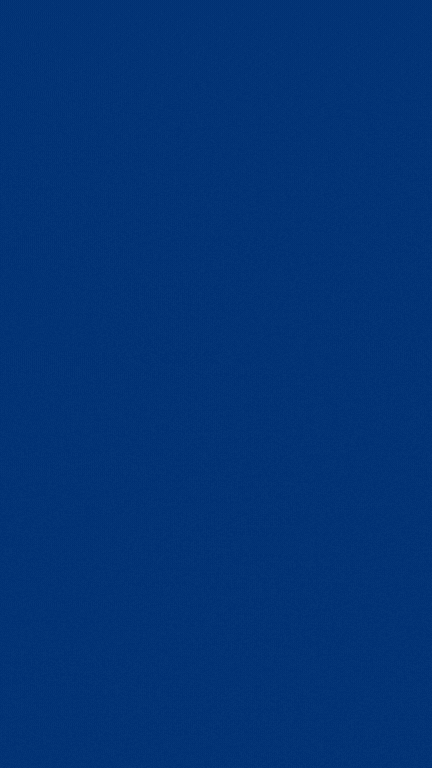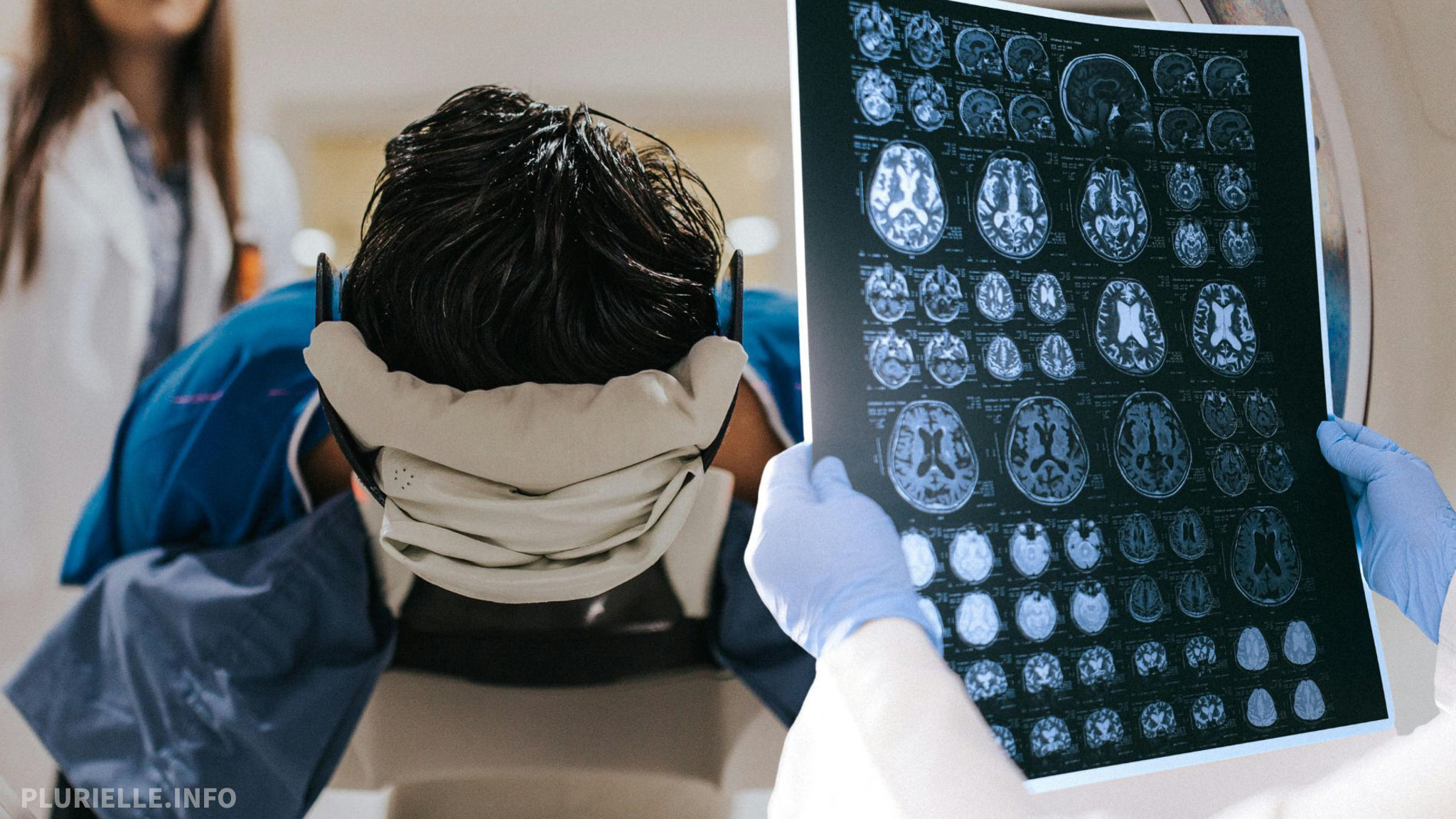Chaque année le 3 mai marque la Journée mondiale de la liberté de la presse, instaurée par l’ONU en 1993 à l’initiative de l’UNESCO.
Ce rendez-vous veut rappeler l’importance d’une information libre, indépendante et pluraliste dans le fonctionnement des démocraties. En 2025, les atteintes à cette liberté se multiplient…
Selon le classement mondial de la liberté de la presse 2024 publié par Reporters sans frontières (RSF), seuls 8 pays sur 180 offrent un environnement jugé « bon » pour les journalistes. La majorité affiche des conditions jugées « problématiques » ou « très graves ». La Norvège, le Danemark et la Suède, très bons élèves, occupent les premières places du classement, tandis que l’Érythrée, la Corée du Nord et l’Iran ferment la marche.
558 journalistes emprisonnés
La France, classée 24e, reste un pays où le journalisme peut s’exercer librement, mais des fragilités s’installent. RSF alerte notamment sur les violences contre les journalistes lors des manifestations, la montée des procédures-bâillons comprendre les procédures judiciaires abusives faites pour intimider ou faire taire les journalistes (SLAPPs), et la concentration croissante des médias dans les mains de quelques groupes industriels.
Dans le monde, 558 journalistes étaient emprisonnés en 2024, à cela s’ajoutent 54 journalistes tués, notamment en zones de guerre ou dans des États autoritaires. La guerre en Ukraine, le conflit à Gaza ou encore la répression en Iran en sont les exemples les plus marquants. Sinon, au moins 749 journalistes ou médias traitant des questions environnementales ont été attaqués au cours des 15 dernières années.
Les menaces ne sont pas seulement physiques. Elles sont aussi numériques et économiques. Surveillance, espionnage, cyberharcèlement ou dépendance aux plateformes posent les vrais défis de l’indépendance éditoriale.
Désinformation, IA génératives, réseaux sociaux
Autre phénomène : la montée de la désinformation, démultipliée par les réseaux sociaux et les intelligences artificielles génératives. Face à ces dangers, l’UNESCO, dans son rapport 2024, appelle à faire de la liberté de la presse « un bien commun mondial ». Elle encourage les États à renforcer les protections juridiques, à lutter contre l’impunité et à soutenir le journalisme de qualité, notamment à travers des aides aux médias indépendants.