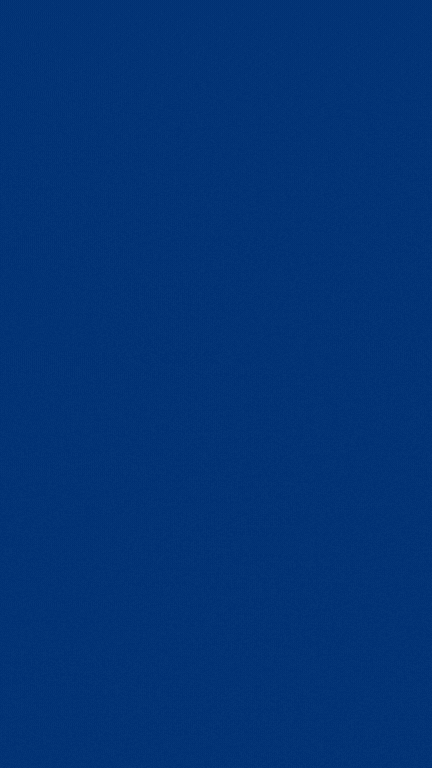[Régis Catinaud, citoyen et candidat sur la liste Nouvelles Pages Pour Sète.] Carnets de campagne #1. À Sète, le constat est évident. Le fonctionnement municipal n’est pas démocratique. Et pourtant, la démocratie participative n’a rien de difficile, rien d’utopique. À l’échelle de cette commune, elle pourrait commencer dès demain.
Une ville de 45 000 habitants est assez petite pour que chacun se la représente mentalement — les quartiers, les canaux, le lido, la mer, l’étang, le port de commerce, le Mont Saint-Clair, le Môle, les lignes de bus, l’Hôpital, le Auchan, le parc du Château-Vert, le Dragon du Kursaal… Les Sétois·es sont a priori en mesure d’en saisir les enjeux et de trouver des solutions aux problèmes qui les concernent. Alors, comment expliquer ce désert démocratique dans une ville pourtant aussi familière et saisissable ?
Posons la question autrement : et si l’on reconstruisait une démocratie vivante depuis la ville elle-même ? Pas une utopie autarcique ; pas une île singulière qui aurait décidé de tourner le dos au monde ; pas un groupe d’autonomistes surexcités qui rêvent de sécession. Non, simplement un endroit où l’on décide ensemble. D’accord, mais concrètement, comment est-ce qu’on s’y prend ?
Le fantasme de l’agora athénienne
D’abord, il faut comprendre de quoi on parle. La démocratie, ce n’est pas une gigantesque assemblée sur la place du Pouffre où toute la population voterait des lois en direct à main levée, comme dans une agora antique. Non, abandonnez tout de suite cette image. Ça, c’est l’épouvantail que les détracteurs projettent immédiatement pour décrédibiliser toute idée de démocratie directe : « la foule est influençable », « les plus bruyants dictent tout », « on ne décide pas à mille », « ça finira à la guillotine ! ».
Parmi ces détracteurs, on trouve d’ailleurs beaucoup d’élus qui ont peur de la foule, peur des questions, peur de la contradiction. Ils acceptent la réunion publique seulement quand elle se résume à un monologue sur une estrade, devant un public qui applaudit poliment. Cette peur du peuple n’est pas anodine : c’est le réflexe de ceux qui ont trop longtemps exercé le pouvoir seuls, loin des gens, loin du tumulte, loin du partage, et qui se rigidifient autour d’une colonne de décision verticale et autoritaire.
Une question de légitimité
Vous voyez le problème ? Il est d’abord éthique. Gouverner en vase clos pose une vraie question de légitimité. Sans parler du fait qu’un pouvoir fermé produit souvent des erreurs, de la mauvaise perception, de la mauvaise politique. À force de réfléchir en petit cénacle, on finit par mal penser. On se persuade qu’on incarne la volonté du peuple… tout en refusant de le rencontrer. À Sète, cela donne : un maire, un cabinet, une micro-sphère de proches, des décisions prises en amont sans concertation, un conseil municipal qui ne sert qu’à valider ce que quelques édiles ont déjà décidé. Dans les mauvais jours, cela donne même du clientélisme, du détournement de fonds publics, et une mise à distance des citoyens des centres de décisions, en fermant par exemple l’accès du public au conseil municipal. Ce que ces élus veulent en réalité de nous ? Un vote, si possible le bon, puis on disparaît. On les laisse décider. Mais quelle est la légitimité des décisions quand on a été élu, comme notre ancien Maire (démissionnaire, car condamné), avec 8 000 voix — soit moins de 20 % des habitant·es ? Il faut bien se représenter ce ratio : seulement 2 personnes sur 10 ont été d’accord pour le mettre aux commandes de la ville. Notre Maire actuel n’a même pas été élu, et il prend toujours des décisions, comme son prédécesseur, sans avoir le réflexe de penser que, peut-être, celles-ci pourraient être pensées et prises avec les habitant·es. Pas à leur place. « Bon d’accord, le pouvoir vertical manque de légitimité. Mais à défaut, il est plus efficace ! ». Non ! Ça aussi, c’est faux !
Le procès de la lenteur et de la complexité
On reproche toujours à la démocratie participative d’être lente, confuse, brouillonne. Trop de blabla, pas assez de décisions. L’image d’un collectif indécis est devenue un argument pratique pour justifier le pouvoir vertical. On répète qu’« il faut bien que quelqu’un tranche », comme si la rapidité valait raison. Mais l’argument du temps ne tient pas. Il est tout à fait possible de décider à plusieurs en temps limité. Il suffit d’une bonne organisation. Donnez un problème complexe à cent personnes correctement structurées, face à un maire seul, et observez qui produit la meilleure solution.
Et par ailleurs, oui, la démocratie prend du temps : c’est le temps de la délibération, le temps de se comprendre, le temps de la décision partagée. Mais dans bien des cas, la lenteur n’est pas un défaut. C’est un amortisseur. Elle évite les décisions brutales, les projets plaqués d’en haut, les « ici on fera un parking, point final ». La lenteur démocratique, c’est le temps de faire le tour de tout le monde. De mettre à jour ce qui n’avait pas été vu. De comprendre une contrainte que d’autres vivent. D’ajuster une idée qu’on croyait évidente. C’est le temps du vivre-ensemble, au sens concret : écouter avant de décider.
Le dialogue pour faire reculer le rejet et la haine
Ce point est essentiel. Le manque d’écoute crée du rejet. Le manque de tolérance crée de la haine. On le voit partout : commentaires en ligne, discussions stériles, clans qui s’opposent. La démocratie, c’est précisément l’inverse. Ce n’est pas se hurler dessus. C’est prendre quelques minutes pour dire : « tiens, je n’avais pas vu cet aspect-là », « d’accord, ton intérêt est différent du mien, voyons comment on fait coexister les deux ». Quand ce travail là est fait — même brièvement —, les gens s’en portent mieux. Les décisions sont de meilleure qualité. Et nos constructions collectives, comme la ville, respirent mieux.
Et puis, si la démocratie participative mérite d’être prise au sérieux, ce n’est pas seulement pour des raisons morales ou symboliques. Ce qu’il faut bien voir, c’est que la démocratie a trois vertus que le modèle vertical du pouvoir ne possède pas.
Trois arguments pour la démocratie participative : efficacité, adhésion, cohésion
La première est l’efficacité. On l’a dit : un groupe bien organisé, avec un sujet clair et des règles de discussion méthodiques, produit de meilleures décisions qu’un petit cercle fermé. Ce n’est pas une intuition, c’est un résultat connu en sciences sociales : la diversité d’informations, de métiers, d’expériences augmente la qualité des solutions. C’est d’autant plus vrai quand on se pose la question à l’échelle d’une ville comme Sète et qu’on demande à ses habitants ce qu’ils en pensent : ils le savent parce qu’ils le vivent. Ça s’appelle l’expertise d’usage.
À l’inverse, les partisans du commandement vertical croient gagner en efficacité. En réalité, ils déplacent simplement le coût des décisions. Les systèmes concentrés ne sont ni plus cohérents ni plus rationnels : ils sont seulement moins contredits. L’autorité donne une illusion de simplicité ; elle ne garantit jamais la justesse, et pas toujours la performance.
La deuxième vertu est l’adhésion. On applique plus volontiers ce que l’on a contribué à construire. Une politique imposée est toujours fragile : elle rencontre de la résistance, de l’inertie, parfois de l’obstruction. Une politique co-produite circule mieux dans la ville. Elle est comprise, appropriée, discutée, et donc plus durable.
La troisième est la cohésion. La discussion collective oblige à reconnaître la légitimité de l’autre. À entendre des positions éloignées. À chercher des compromis. On cesse de monter les groupes les uns contre les autres. On reprend conscience que la ville est un collectif pluriel, pas un ensemble de segments séparés que l’on instrumentalise selon les moments.
Alors, la démocratie directe, merveille et remède à tout ?
Tout dispositif de décision comporte des biais : domination symbolique, asymétries sociales, rapports de force, différences de maîtrise de la parole. Les travaux sur les groupes l’ont bien montré : la discussion libre — la « démocratie directe » spontanée — reproduit souvent des effets de leadership ou de captation. Aucun mode de décision n’est parfait. La démocratie n’échappe pas aux défauts. Mais elle a cet avantage décisif : elle rend ses défauts visibles, là où le pouvoir fermé les camoufle.
Oui, la démocratie est parfois compliquée : du contradictoire, des gens pas d’accord, des échanges intenses. Et on la critique souvent pour cette raison même : parce que ça parle fort, parce que ça débat, parce que ça frotte. Mais ce qu’il faudrait interroger, ce n’est pas l’existence du conflit — c’est son absence. Quand il y a débat, il y a expression. Quand il y a désaccord, il y a mise à plat. Et quand les choses sont dites, on peut identifier ce qui ne fonctionne pas et le corriger. La démocratie ne supprime pas le conflit : elle le rend traitable. C’est sa force.
Alors, bien entendu, la démocratie ne fonctionne pas toute seule. Elle demande de l’attention, de la méthode et des outils. Mais lorsqu’elle est bien conduite, elle produit des décisions plus robustes, plus acceptées, plus durables que celles imposées d’en haut. La clé, c’est vraiment la méthode. Et encore une fois, rien de sorcier : il suffit de choisir, pour chaque question, le bon outil (réunion, décision au consentement, consensus, référendum, forum ouvert…), et de se donner des moyens très simples — un lieu où se réunir, de quoi noter, un déroulé clair, une personne pour animer, un cadre explicite de discussion. Et surtout : s’autoriser à essayer, à tâtonner, à échouer. La démocratie n’est pas une idée qui se décrète, c’est un processus qui s’apprend. Par tâtonnement, par essai-erreur, par la mise en place de techniques. C’est ce qu’on peut appeler une « technologie sociale ».
Technologie ? Ce n’est pas le suppôt du capitalisme ça ?
On associe aujourd’hui le mot « technologie » aux machines, aux algorithmes, aux infrastructures industrielles, à ce qui fait courber l’échine du travailleur, à ce qui nous éloigne. Pourtant, dans son sens premier, la technique est simplement une manière de faire. Une manière de faire ancrée, répétée, partagée, qui finit par structurer une pratique collective. La démocratie peut être pensée ainsi : non comme un idéal abstrait, mais comme une technologie sociale qui se construit, se teste, s’améliore.
Une technologie démocratique n’a rien de la froideur d’une machine. C’est un ensemble de gestes, de formats, de rituels, de règles du jeu, qui permettent à un groupe d’habitant·es de produire des décisions en commun. Dans une ville, cette technologie a un objectif clair : fabriquer du nous. Pas un nous fusionnel, homogène, qui obligerait chacun à se dissoudre dans le groupe, mais un nous minimal, suffisant pour tenir ensemble malgré les différences, malgré les désaccords, malgré les intérêts divergents. Le contraire exact, en somme, de la logique contemporaine de dispersions : chacun enfermé dans ses colères, les appartenances qui se rigidifient, les oppositions qui deviennent des identités revendiquées. Piétons contre vélos, vélos contre voitures, centre-ville contre quartiers populaires, « Sétois de souche » contre « néo-sétois », ceux « d’ici » contre ceux « d’ailleurs »… À force de polarisation, la haine de « celui d’en face » remplace l’argumentation. On ne parle plus, on se déteste. Par principe.
La technologie démocratique n’a pas pour fonction de lisser ces différences ni d’effacer les rapports sociaux, les conflits de position ou les inégalités. Tout du moins pas dans un premier temps. Elle sert seulement à les rendre discutables. À faire apparaître les intérêts. À déposer sur la table les différentes couches de pensée : ce que je vois depuis ma rue, ce que je vis dans mon quartier, ce que je comprends pour la ville, pour le port, pour le commerce, pour la montée des eaux à venir et les habitant·es qui vont en souffrir. Je peux formuler un intérêt très local dans ma rue — par exemple vouloir un stop plutôt qu’un céder-le-passage sur la Caraussane pour limiter les comportements dangereux — et simultanément penser à l’échelle urbaine : l’agriculture sur mer, la résilience littorale, les zones de fraîcheur pour faire face au changement climatique.
La démocratie permet cela : articuler mes intérêts immédiats et les intérêts collectifs, reconnaître que d’autres ont des perceptions différentes, et travailler avec ces différences plutôt que les nier. À l’échelle municipale, cette fabrication du nous devient tangible. La démocratie se présente alors comme une technique de maintien collectif : une ingénierie identitaire au sens simple, qui permet à une pluralité d’habitant·es de se reconnaître comme un collectif sans gommer leurs divergences.
Nouvelles Pages… et l’esprit démocratique
À Sète, il va falloir réapprendre à décider ensemble. Au niveau municipal, nous sommes encore au degré zéro de ce qui serait possible. Mais ce constat institutionnel ne doit pas masquer ce qui existe déjà sur le terrain. Il y a eu des luttes locales — sur les parkings, la place Aristide Briand, la marina, et d’autres projets passés et à venir. Il existe des associations, des collectifs, des groupes informels. Des lieux où l’on se rassemble : feu le 51, la Baraquette Citoyenne, l’Atelier Révolution, et d’autres que je préfère ne pas citer pour les préserver. Le terreau est là. La vitalité aussi.
Aujourd’hui, à Sète, une liste porte explicitement ces valeurs démocratiques. Nouvelles Pages est un mouvement citoyen qui a imaginé un répertoire d’outils simples applicables à l’échelle de la ville — pas des dogmes, pas des machines bureaucratiques, mais des techniques de démocratie réelle. Par exemple des Assemblées de quartier dotées de moyens, pour traiter les enjeux quotidiens au plus près du terrain ; des Conventions citoyennes pour instruire les grands projets urbains, écologiques et sociaux. Rien d’exotique. Rien de compliqué. Juste des manières de faire, éprouvées ailleurs, adaptées ici.
Il y a de l’espoir pour que cette liste gagne les élections. Mais, au fond, la démocratie ne peut pas dépendre du résultat d’un scrutin. Une ville n’a pas à attendre l’autorisation de son exécutif pour se gouverner elle-même. Assemblées, ateliers, inventer des formats, occuper des espaces délaissés, débattre publiquement, tester, corriger, recommencer : tout cela peut exister dès lors que des habitant·es décident que cela doit exister. La démocratie locale n’est pas un cadeau accordé par le pouvoir. C’est une pratique que la société doit se réapproprier, en l’exerçant dès maintenant. Plus on la pratique, plus elle devient possible. Plus on l’active, plus elle s’amplifie.
Alors, que Nouvelles Pages gagne ou perde, il restera toujours un impératif : la volonté — et la joie, parce qu’il y en a — de se lancer. De créer des espaces de décision et d’action collective, ou de rejoindre ceux qui existent déjà. Rien n’empêche de commencer. Donnons-nous rendez-vous au printemps, quoi qu’il arrive, pour proposer, tester, apprendre, et faire vivre une démocratie concrète, ici et maintenant.
Pour aller plus loin
Quelques repères pour comprendre la démocratie locale
L’échelle municipale comme terrain naturel du politique
L’idée que la ville — plutôt que l’État — constitue l’échelon pertinent de la démocratie directe vient de Murray Bookchin. Dans From Urbanization to Cities (1995), texte fondateur du municipalisme, il montre que la ville est une “unité cognitive humaine” : un espace lisible, traversable, où les habitants peuvent comprendre les enjeux, se reconnaître comme communauté politique et s’auto-gouverner. Cette intuition structure aujourd’hui encore une grande partie des mouvements municipalistes contemporains.
L’efficacité démocratique et l’intelligence collective
Dans Democracy When the People Are Thinking (2018), James S. Fishkin démontre que des groupes de citoyens tirés au sort, informés de manière pluraliste et encadrés par une facilitation rigoureuse, produisent des décisions plus cohérentes et plus rationnelles que les cercles fermés du pouvoir traditionnel. Pour une version plus accessible de ces résultats, on peut lire Mehdi Moussaïd, A-t-on besoin d’un chef ? (2022), ou sa chaîne YouTube Fouloscopie (https://www.youtube.com/c/Fouloscopie), qui vulgarisent les apports scientifiques de l’intelligence collective.
Pourquoi la méthode compte autant que l’intention
La démocratie participative ne “marche” pas spontanément. Sans structure, un groupe reproduit exactement les biais qu’on prétend éviter. C’est ce que Joan Freeman avait parfaitement montré dès 1972 dans The Tyranny of Structurelessness : l’absence de règles explicites laisse la place aux hiérarchies invisibles plutôt qu’à l’égalité réelle. C’est pour cela que la participation nécessite une méthode. Les travaux de James S. Fishkin (Democracy When the People Are Thinking, 2018), Hélène Landemore (Open Democracy, 2020), Loïc Blondiaux (Le nouvel esprit de la démocratie, 2008) et Graham Smith (Democratic Innovations, 2009) montrent que la qualité du dispositif détermine la qualité de la décision. Autrement dit : ce n’est pas seulement “la foule” qui décide — c’est aussi la méthode qui rend la foule intelligente.
La démocratie du quotidien : conversations, lieux, apprentissages
Dans Everyday Talk (1999), Jane Mansbridge rappelle que la démocratie ne naît pas seulement dans les grandes conventions ou panels citoyens : elle se fabrique aussi dans les échanges ordinaires — discussions de voisinage, vie associative, sociabilités locales. Une ville comme Sète dispose déjà de ces micro-espaces : cafés, collectifs, associations, lieux militants. À ce sujet, on ne manquera pas de rappeler que la tête de liste de Nouvelles Pages pour Sète, Laura Seguin, a exploré ses questions avec son travail Les apprentissages de la participation (2016) qui montre que les dispositifs participatifs sont de véritables écoles politiques : on y apprend à argumenter, écouter, confronter des points de vue, comprendre des contraintes techniques ou écologiques, et coopérer. Loin d’être une consultation ponctuelle, la participation crée des compétences démocratiques durables — individuelles et collectives.