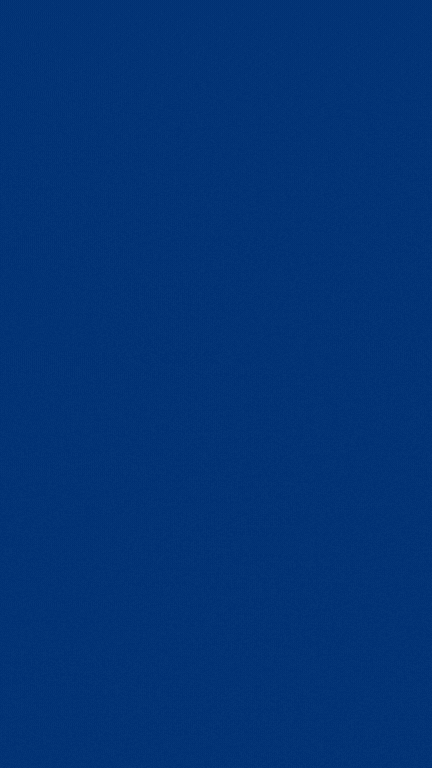Le nouveau maire de Gotham City, pardon, de New York, est donc Zohran Mamdani, candidat se revendiquant comme socialiste et qui dénonce avec virulence la complicité des États-Unis avec les crimes de masse commis par l’armée israélienne au Moyen-Orient. Ce n’est pas la première fois qu’un homme politique réputé de gauche remporte la mairie de New York.
Ce n’est pas la première fois, c’était déjà le cas de Bill de Blasio en 2013. Il est en revanche beaucoup plus étonnant de voir que Zohran Mamdani a réussi depuis une position de marginal diabolisé à la fois par la direction du Parti Démocrate et par celle du Parti Républicain, et avec eux par la presse américaine qui s’est livrée à une grande campagne pour l’accuser d’antisémitisme.
Suite à cette surprise, on entend tout et n’importe quoi au niveau des commentaires politiques, chacun voyant midi à sa porte. On peut effectivement tirer des leçons de cet évènement, mais pas sans remettre les choses dans leur contexte américain et new-yorkais pour éviter de dire des bêtises.
Or la première chose à comprendre, c’est que les États-Unis ont un système politique bipartisan très différent de ce que l’on connaît en Europe continentale. Les partis politiques et la façon dont ils se constituent en système étant le sujet de prédilection de l’auteur de ces lignes, je vais tenter d’expliquer la façon dont ils se sont construits aux États-Unis, leur fonctionnement puis le contexte de New York dans lequel Zohran Mamdani a réussi à défaire ce système, pour comprendre cet évènement et avoir des éléments de contexte sur la politique américaine en général.
Un bipartisme dans un pays construit par l’immigration
Lorsque l’on dit que les États-Unis sont un système bipartisan, cela signifie non pas qu’il n’y aurait vraiment que deux partis politiques aux États-Unis, il y en a bien d’autres (un parti écologiste, des partis socialistes de différentes chapelles, des libertariens, un parti nazi… tout ce que vous voulez), mais que le Parti Républicain et le Parti Démocrate sont les seuls à avoir réellement un poids sur la politique américaine nationale, parce qu’ils peuvent se passer de tous les autres, là où les plus grands partis politiques français, allemands et ainsi de suite ont toujours eu besoin de séduire les électeurs d’au moins un troisième parti, souvent plus. Mais surtout, ce qu’en Europe on n’arrive pas à se fourrer dans le crâne au sujet des États-Unis, c’est que le clivage entre ces deux partis n’a rien à voir avec la gauche et la droite, en tout cas à l’origine.
Pour comprendre ce système partisan, il faut se rappeler que les États-Unis sont un pays construit par des vagues d’immigration : d’abord l’immigration violente de populations d’Europe de l’Ouest qui ont profité du fait d’être totalement surarmées par rapport aux sociétés indigènes pour massacrer ces peuples et constituer leurs colonies, parmi lesquelles celles fondées par les Anglais ont pris l’ascendant ; ensuite l’immigration forcée de populations africaines d’esclaves vendus aux Européens, envoyés aux Amériques pour servir de main-d’œuvre aux colons ; enfin, après l’indépendance des États-Unis et leur développement, l’immigration pacifique de gens venus y chercher une vie meilleure, Irlandais fuyant la catastrophe alimentaire qui s’abattait sur leur pays, Juifs d’Europe de l’Est désirant un pays plus accueillant à leur égard, Italiens et Polonais cherchant leur place dans l’essor économique, petits groupes religieux rigoristes comme les amish souhaitant vivre en communautés dans un pays vaste… Mais tous ceux qui sont arrivés après ont dû jouer selon les règles des colons déjà présents, blancs, anglo-saxons et protestants d’obédiences diverses, mais généralement méfiantes envers le pouvoir d’État (contrairement aux luthériens).
Cette construction par vagues d’immigration successives a généré un effet étonnant, c’est que la lutte des classes a été très longtemps anesthésiée aux États-Unis. En effet, les colons blancs arrivaient sur un territoire immense, où par conséquent le prix de la terre était faible ; de sorte qu’un ouvrier ou un domestique blanc en Amérique du Nord a longtemps eu des chances non négligeables de pouvoir acquérir une terre afin d’échapper à sa condition de salarié une fois qu’il aurait économisé assez d’argent, et pourquoi pas d’employer à son tour des salariés ou même d’acheter des esclaves. Cela a généré une sorte de fluidité entre les classes chez les blancs américains. Ce n’était pas du goût des grands propriétaires terriens et des capitalistes car enfin, dans ce cas, qui allait continuer à les servir ? Des mesures ont été prises pour imposer des prix planchers aux terres dans le but de limiter cet effet, mais cette fluidité a trouvé de nouvelles sources avec les débuts de l’industrialisation : comme celle-ci a d’abord été textile aux États-Unis et que cela nécessitait peu d’investissements, il y a eu une longue période où des gens qui n’étaient pas très riches ont pu réussir aux États-Unis comme petits capitalistes. Enfin, les travailleurs blancs anglo-saxons ont pu construire leur élévation sociale en laissant les plus bas salaires et les travaux les plus pénibles aux vagues d’immigration suivantes et aux noirs affranchis de l’esclavage, et ainsi de suite jusqu’à nos jours avec les vagues de migration suivantes.
Un type de partis politiques construit hors de la lutte des classes
Cela a abouti à ce que les partis politiques américains ne se construisent pas sur des clivages de classe, contrairement à l’Europe où ils ont été forgés par la lutte de la bourgeoisie contre l’aristocratie et le clergé puis par les travailleurs salariés qui ont tenté de se faire une place entre eux tout au long du XIXe siècle. La bourgeoisie ayant clairement pris les rênes des États-Unis une fois chassée l’aristocratie anglaise, le Parti Démocrate et le Parti Républicain se sont d’abord construits comme des coteries de notables, les vainqueurs des élections distribuant les postes de l’administration à leurs fidèles et achetant les voix des électeurs plus pauvres. Il y a certes un clivage politique qui a tout de même émergé entre eux au XIXe siècle : le Parti Démocrate était un parti décentralisateur, favorable à laisser le plus de pouvoir possible aux États, tandis que le Parti Républicain était un parti centralisateur, favorable à transférer le plus de compétences possible à l’échelon fédéral. C’est pour cela qu’Abraham Lincoln, défendant une abolition de l’esclavage au niveau fédéral, était au Parti Républicain tandis que ses opposants étaient au Parti Démocrate, tout comme l’ont été ensuite les partisans de laisser aux États la liberté de mettre en place une ségrégation des noirs.
Cela a aussi abouti à ce que ces partis s’organisent de manières différentes des partis politiques européens, comme des partis « stratarchiques », où chaque échelon peut décider de son organisation, de son programme et de ses priorités, ce qui serait idiot s’il s’agissait de lutter pour un projet politique national comme les partis européens, mais ce n’était pas le but ici, ces partis n’ayant pas de doctrine très précise. Pour cette raison, les partis américains ont fini au cours de leur histoire par mettre en place le mode de désignation de leurs candidats que l’on appelle les primaires ouvertes : les électeurs qui ne sont pas adhérents à l’un des deux partis peuvent voter pour élire qui sera le candidat de ce parti, a contrario des partis de masse européens qui préfèrent historiquement réserver cet avantage à leurs adhérents pour en recruter le plus possible et partent du principe qu’une bonne connaissance de la doctrine de l’organisation est nécessaire pour désigner le plus apte à la représenter.
Ceci étant dit, cela n’a pas empêché une gauche d’émerger aux États-Unis lorsque le fossé a commencé à se creuser entre les classes, le pays étant rattrapé comme le reste du monde capitaliste par la constitution d’oligopoles dans la plupart des secteurs de l’économie. Cette gauche a d’abord pris la forme d’un troisième parti représentant les petits paysans jusqu’au début du XXe siècle, le Parti Populiste (People’s Party, c’est de là que vient le mot, peu avant qu’il ne soit aussi utilisé pour désigner le parti d’extrême gauche russe Narodnaya Volya), puis de syndicats et de petits partis socialistes. Elle n’a cependant jamais réussi à créer un troisième pôle durable, aussi ses militants ont-ils été très tôt tentés de rejoindre l’un ou l’autre des deux grands partis bourgeois pour tenter de les subvertir de l’intérieur : des syndicalistes sont ainsi devenus des élus du Parti Républicain jusque vers le milieu du XXe siècle, tandis que d’autres militants de gauche ont rejoint le Parti Démocrate qui a commencé à reprendre des revendications du Parti Populiste, surtout une fois que Franklin Delano Roosevelt, président PD, a impulsé le virage économique interventionniste qu’on appelle le « New Deal ».
La gauche et les grands partis américains
Cette question de savoir si le parti démocrate est ou non à gauche du parti républicain n’a jamais été vraiment résolue : ça dépend des périodes. Lorsque Kennedy puis Johnson se sont mis à défendre les droits des noirs dans les années soixante/soixante-dix en même temps qu’ils appliquaient une politique économique keynésienne (qui ferait hurler d’horreur ceux qui croient que la taxe Zucman est une mesure d’extrême gauche, soit dit en passant), il semblait que oui, et c’est à ce moment que les affreux ségrégationnistes ont quitté le parti démocrate ; mais ça n’a pas été le cas sous Bill Clinton et lorsque George W. Bush fils est arrivé au pouvoir, le parti démocrate n’a pas spécialement protesté contre sa politique de privatisations et a massivement soutenu la guerre en Irak, Barack Obama était l’un des rares à y être hostile. Lorsque Obama est à son tour devenu Président des États-Unis sur un programme de protection sociale et de relance de l’économie, son propre parti a tout fait pour limiter ses mesures et il y est parvenu.
Ironiquement, si le parti démocrate est incapable de se placer durablement à gauche, le positionnement à droite du parti républicain ne fait quant à lui plus aucun doute : Ronald Reagan a cassé les politiques de redistribution et la fiscalité qui pesait sur les grandes fortunes et affirmé un virage conservateur sur les questions culturelles, une orientation jamais démentie par ses successeurs ; plus encore, le parti a commencé sous George W. Bush à devenir très sensible à l’influence des Églises protestantes les plus réactionnaires, en particulier celles qui ont une approche néo-charismatique (les pentecôtistes, dans une moindre mesure les baptistes, les adventistes qui ne sont pas des évangéliques à proprement parler, mais qui s’en approchent) ainsi qu’à celle des mormons qui sont un cas à part dans le monde chrétien. À présent que Donald Trump et ses fidèles, dont certains sont franchement des hurluberlus, ont pris le contrôle du PR (ce n’était pas le cas durant son premier mandat), on peut dire que l’orientation qui y domine au niveau national est même d’extrême droite, articulant nationalisme agressif, racisme très peu dissimulé, masculinisme, autoritarisme et fondamentalisme religieux, quand bien même il paraît étrange que des chrétiens rigoristes soutiennent un homme qui se vante d’« attraper les femmes par la chatte ». Pour autant, la faible discipline des partis américains et leur décentralisation fait que même maintenant, le PR ne peut pas se transformer en un véritable parti fasciste avec ses milices et son fonctionnement totalitaire ; mais cela ne veut malheureusement pas dire qu’il fera forcément moins de dégâts, l’histoire est inventive quand il s’agit du pire.
Voilà donc comment s’explique l’étrange rapport des socialistes américains au parti démocrate, pas de gauche, franchement vendu au néolibéralisme, absolument odieux dans ses positions vis-à-vis de la Palestine, et pourtant différent d’un parti républicain devenu trop gravement à droite… C’est pour cela que Zohran Mamdani a brigué son investiture, comme Bernie Sanders l’a fait par deux fois à l’échelle nationale pour les élections présidentielles, même s’il existe aussi des socialistes qui cherchent à se construire en dehors de lui. C’est ainsi également que s’explique le fait que participer à des primaires ouvertes est une démarche peu discutée aux États-Unis : dans ce contexte où les électeurs n’ont le choix qu’entre deux partis politiques d’un poids significatif, les risques de fuite des déçus vers une formation concurrente sont faibles, et ces appareils qui ne sont ni très cohérents ni très disciplinés peuvent plus facilement s’adapter au vainqueur de la primaire.
Une fois que l’on a bien cerné le système partisan américain, il reste à comprendre comment Zohran Mamdani a pu gagner contre ce système entièrement dressé contre lui.
New York, ville construite par les inégalités et l’immigration
Pour le comprendre, il faut se pencher sur New York. New York a été littéralement construite par l’immigration : c’est là que sont arrivés massivement à partir du XIXe siècle les migrants venus d’Europe puis de partout dans le monde tenter leur chance dans ce nouveau monde où d’autres avaient réussi, là qu’on les a employés à construire les bâtiments et aux travaux les plus ingrats tandis que d’autres devenaient extrêmement riches. Pour cette raison, la ville est devenue extrêmement inégalitaire, avec d’immenses quartiers pauvres où sont apparus les phénomènes de ghettoïsation, les Juifs au début du XXe siècle puis les noirs se retrouvant à habiter massivement de mêmes quartiers peu chers ; naturellement, des quartiers latino-américains et asiatiques sont eux aussi apparus par la suite. Cela a créé une pépinière pour le crime organisé, notamment des organisations italiennes (déjà bien structurées en Italie du Sud avant de s’exporter), mais aussi irlandaises et juives, ou plus tard afro-américaines, qui se sont substituées au travail que les pouvoirs publics ne faisaient pas. Mais à côté de ces poches de misère géantes, New York est aussi une ville d’opportunités, qui par conséquent attire massivement des gens très diplômés. Enfin, c’est la ville où les travailleurs salariés américains ont été les plus nombreux et les plus syndiqués.
Pour ces raisons, et en dépit de toute la méfiance envers l’État qui est répandue aux États-Unis, New York a un temps développé des services publics plus puissants qu’ailleurs, mettant en place des hôpitaux, un important réseau de transports, des logements sociaux, des musées et des théâtres gratuits, des piscines… Jusqu’en 1975 où, dans le contexte de crise économique, la ville ne parvient plus à payer ses installations ambitieuses ; l’État central ayant refusé de voler à son secours, la ville de New York s’est retrouvée à négocier avec les marchés des politiques d’austérité qui ont démantelé ces politiques sociales grâce auxquelles New York était devenue malgré tout vivable. Bill de Blasio n’a pas réussi à inverser la tendance et sans doute son parti ne voulait-il pas vraiment essayer.
Il y a là de quoi avoir un énorme sentiment d’injustice, a fortiori chez de jeunes diplômés qui s’attendaient à de meilleures conditions d’existence et se sentent davantage de légitimité pour critiquer les programmes politiques. À cela s’ajoute le phénomène d’une jeunesse américaine, y compris juive, qui se sent en décalage avec la politique de son pays au Moyen-Orient, consciente que celle-ci est aux antipodes des valeurs proclamées en théorie par les États-Unis et que le régime israélien peut se permettre ce qu’il fait parce qu’il est surarmé par les États-Unis comparé à ses voisins.
On comprend donc l’engouement suscité par la candidature d’un homme politique relativement jeune (il est né en 1991), qui propose de reconstruire de puissants services publics notamment en matière de logement et de transport en les finançant par l’imposition des grandes fortunes, et qui de surcroît critique avec virulence le système américain et sa politique étrangère. Il a trouvé pour l’aider non pas la machine du Parti Démocrate, mais le soutien de dizaines de milliers de militants bénévoles s’organisant de manière autonome. Le fait qu’il soit né en Ouganda de parents indiens et membre d’une minorité religieuse (il est musulman) n’a pas été un handicap dans ce contexte : de nombreux New-Yorkais ont reconnu les injustices de leur histoire familiale à travers son parcours sur ce plan, quand bien même il vient d’un milieu privilégié sur le plan économique et culturel (il est fils d’un universitaire et d’une cinéaste) ; ses adversaires ont fait une erreur de calcul en choisissant son origine et sa religion pour l’attaquer. Le fait qu’il se revendique comme socialiste, ce qui est historiquement tabou aux États-Unis, a quant à lui visiblement été perçu comme une garantie que lui au moins était réellement déterminé à changer les choses dans le bon sens.
C’est autre chose de savoir s’il y parviendra : il va devoir composer avec un conseil municipal qui lui n’est pas socialiste et avec l’État de New York, qui contrôle en grande partie les impôts que la ville peut mettre en place. Sans doute en est-il conscient, d’où son programme somme toute modéré.
Ce sont en tout cas bien son projet et le combat qu’il mènera pour l’imposer qui sont importants, certainement pas son origine et sa religion qui concentrent les commentaires imbéciles des obsédés de l’identité en France alors qu’ils n’auront a priori aucun impact sur les mesures qu’il mettra en place pour les habitants de New York. On se contentera aussi d’un soupir consterné en voyant se réjouir de sa victoire en France des dirigeants politiques et un journal qui de toute évidence l’auraient traité d’antisémite s’il avait tenu le même discours ici, et d’un sourire navré pour celles et ceux qui croient que ce que sa victoire démontre, ce serait qu’il ne faut pas critiquer le système en place et que les primaires sont forcément une bonne chose.
Il n’y a pas de recette magique, mais le projet et la combativité, eux, sont obligatoires.