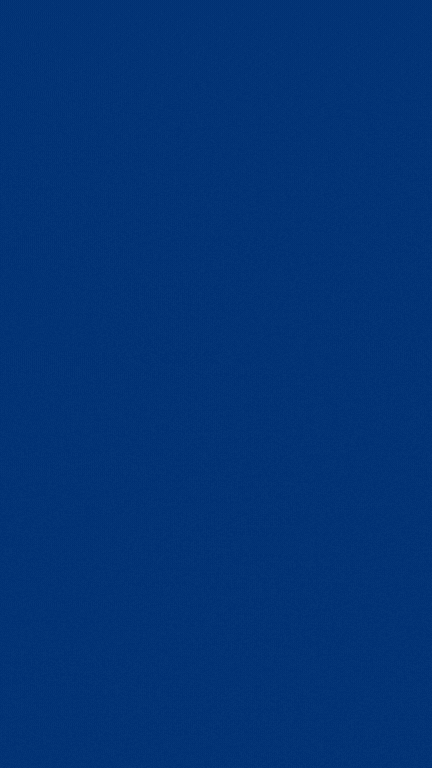Y a-t-il une façade de la « résilience » qui masque la dépendance et les fractures du modèle agricole régional ? La 8e édition d’Agri’scopie Occitanie 2025, c’est 58 pages difficiles à consommer en un seul petit-déj et deux heures de conférence de presse. L’info est complète, détaillé et riche. Le tout offre l’image d’une agriculture régionale « résiliente », « adaptative » et « diversifiée ».
Publiée par la Chambre régionale d’agriculture et Cerfrance, cette édition, très dense, se rapproche parfois trop d’un exercice de communication. Sous une présentation policée, le décryptage chiffré révèle une réalité beaucoup plus préoccupante : impacts d’incendies à répétition, dérèglements climatiques, contexte international et géopolitique tendu (avec notamment une majoration de 15 % des droits de douane pour les exportations vers les États-Unis). Sans compter certaines pressions foncières masquées : via des opérations de compensation environnementale. On peut noter celles dues aux opérations d’infrastructures du type COM ou LIEN autour de Montpellier, qui feraient passer « la valeur des terres agricoles de 15 000 à 50 000 € l’hectare ». Lâchant cela entre deux questions, Denis Carretier, président de la Chambre régionale d’agriculture Occitanie, semble nourrir une forte animosité envers cette politique de compensation, qu’il accuse de priver nombre d’agriculteurs de la possibilité de mener des exploitations viables.
Tout n’est pas rose en Occitanie
D’autant que l’équivalence écologique est difficile à établir : les milieux compensés ne reproduisent pas toujours les services écologiques perdus ni la biodiversité originale. Ces mesures compensatoires s’apparentent souvent à une forme de spéculation verte plus qu’à une véritable restauration. Bref ! Tout n’est pas rose en Occitanie. Ajouter à cela l’eau, plutôt le manque d’eau qui reste une question conflictuelle. Mais comme le dit Denis Carretier : « avec de l’eau, cette région sera l’Eldorado de l’Europe. » Reste à savoir à quel prix, et pour qui on ouvrira les vannes ? Rappelons sa réflexion, il y a quelques mois : « il ne faudrait pas que la sauce coûte plus cher que le poisson ». Or, s’il est bien un chiffre absent de cette Agri’scopie, c’est celui-là : le coût réel de l’eau, son évaluation et sa modélisation selon les différents scénarios climatiques à venir.
Mais revenons au document réalisé par le Pôle Economique et Prospective (PEP) de la Chambre régionale d’agriculture. L’Occitanie reste la première région agricole de France par le nombre d’exploitations, plus de 64 000 selon le recensement 2020, mais elle en perd chaque jour plusieurs. Et la tendance, loin de se ralentir, s’accélère : -1,8 % d’exploitations par an sur la dernière décennie.
En parallèle, la population régionale croît rapidement, accentuant la pression urbaine sur les terres agricoles et accélérant la disparition des petites fermes. Le rapport mentionne pudiquement cette érosion tout en valorisant la « densité agricole » de la région, encore deux fois supérieure à la moyenne nationale. Cette densité ne dit rien du déséquilibre interne : Toulouse, Montpellier et le littoral captent l’essentiel de la croissance démographique et économique, laissant à l’écart une large partie de l’intérieur rural. Dans le Gers, l’Aveyron ou la Lozère, le maillage agricole et social se délite lentement, à mesure que les exploitations disparaissent et que les services publics se raréfient.
Les agriculteurs vivent dans une véritable incertitude
En conférence de presse, il est annoncé une « diversité de productions » et de « territoires complémentaires », mais quid de la dualité entre agriculture intensive de plaine et élevage extensif en zones défavorisées ? Sur le plan économique, la présentation flatteuse des « filières d’excellence » ne suffit pas à masquer la faiblesse structurelle des revenus. Pour Patricia Granat, Présidente de Cerfrance « il y a une réalité, que vivent les agriculteurs, c’est une véritable incertitude. »
En 2023, le revenu courant avant impôt (RCAI) moyen par actif agricole n’atteint que 19 400 euros, soit moins de la moitié de la moyenne nationale. L’Occitanie concentre 17 % des exploitations françaises, mais seulement 8 % de la valeur ajoutée agricole. Ses exploitations demeurent petites (49 ha en moyenne contre 65 ha au niveau national), peu mécanisées et dépendantes des subventions européennes qui représentent 41 % du résultat brut d’exploitation, un record national.
Une dépendance qui s’accompagne d’une fragilité croissante. Les charges par hectare progressent plus vite que les revenus (+14 % en 2023), notamment à cause du coût des engrais et de l’énergie. L’excédent brut d’exploitation chute à 241 euros par hectare. Un tiers des exploitations n’a plus la capacité d’autofinancer ses investissements, et 12 % sont classées en « danger » ou « urgence » financière.
Pour une agriculture performante et résiliente
Pourtant, la synthèse présentée préfère souligner « la stabilité du tissu agricole » et « l’adaptabilité des exploitants », tout en projetant cette formule dans un slide derrière les intervenants : « pour une agriculture performante et résiliente, face au changement climatique. »
Ainsi, l’autre grand angle serait celui de « l’adaptation au changement climatique », qui semble relever davantage du discours que de la stratégie. Si tous affirment ce 29 septembre 2025 que le climat est « au cœur de toutes les réflexions », l’essentiel des solutions avancées demeure productiviste : recours accru à l’irrigation, maintien des grandes cultures exportatrices, développement des semences à haute valeur ajoutée. Et de facto, l’eau y est envisagée comme un levier de compétitivité, non comme une ressource finie.
Idem pour les « filières émergentes » mises en avant : légumineuses, forêt, circuits courts, elles tiennent du symbole. Elles représentent à peine 8 % de la sole (surface cultivée d’un même type de production, NDLR) en grandes cultures. Le soja non-OGM, vanté comme alternative vertueuse, voit ses surfaces reculer de près de 40 % en un an, faute d’irrigation et à cause de pressions parasitaires. Quant à l’agriculture biologique, elle marque un net ralentissement : 21 % des exploitations en bio ou conversion, un chiffre en stagnation après plusieurs années de forte progression.
Cette stagnation est d’autant plus significative que la rhétorique officielle met en avant la « transition agroécologique ». Or, aucune inflexion de fond n’apparaît dans les pratiques dominantes. Le modèle demeure celui d’une agriculture marchande, tournée vers l’export (13 % des exportations régionales) et dépendante des filières industrielles. Cette 8e édition cite avec fierté la « 1re place nationale pour la viticulture » ou la « 2e pour les fruits », mais ces réussites reposent sur des filières fortement intégrées, où la valeur ajoutée échappe souvent aux producteurs.
Une agriculture en résistance plus qu’en transition
Autre point qui n’est pas un détail; la majeure partie des exploitations opèrent dans des conditions économiques dégradées et climatiques extrêmes. 85 % du territoire régional est classé en zone à handicap naturel (ZHN), dont 70 % en zone défavorisée simple. Comprendre ces 3 lettres ZHN, ce sont des territoires où les conditions naturelles rendent l’agriculture plus difficile que dans le reste du pays.
Autrement dit, l’agriculture du territoire, contrairement au récit institutionnel de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie, n’est pas « en transition », mais en résistance permanente à un environnement devenu structurellement hostile : sécheresses répétées, concurrence foncière, surcoût énergétique, instabilité des prix.
Agri’scopie, édition 2025 reste un outil précieux pour mesurer ces contradictions. Ce qu’il réussit à documenter, sans l’assumer, c’est une agriculture sous contrainte : dépendante des aides, vulnérable aux marchés, et soumise à une pression climatique croissante.
Derrière la façade d’une « résilience » célébrée à chaque page, comme en conférence de presse, c’est une économie agricole régionale en déséquilibre qui s’expose, à la recherche d’un nouveau modèle dont personne, pour l’heure, ne semble vraiment vouloir définir la voie. Reste donc à semer l’avenir en Occitanie.