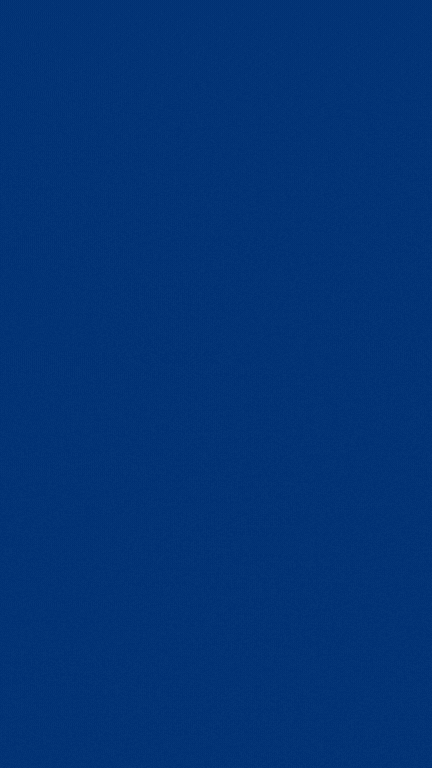Journées d’été des Écologistes, le 21 août 2025, la conférence « Souveraineté alimentaire : laquelle, comment ? » a levé le voile sur une réalité : derrière le vernis, un système colonial défaillant.
Alors que la France proclame son ambition de souveraineté alimentaire en incluant le terme dans la loi en mars 2025, ce concept est encore un écran de fumée camouflant la perpétuation d’un système hérité du colonialisme et d’une dépendance accrue à des importations aux coûts sociaux et environnementaux exorbitants. « la loi proclame la souveraineté alimentaire pour la France, mais pas pour les autres », rappelait Robin Petit Roulet, co-responsable de la commission agriculture et ruralités, animateur de la conférence.
Ce système organise des cultures destinées à l’importation massive en France, au travers de circuits qui bénéficient trop souvent à des entreprises françaises avec des accords commerciaux plutôt problématiques. Les tomates marocaines, par exemple, qui focalisent une « concurrence vue comme déloyale, que la France a pourtant elle-même organisée et dont certaines de ses entreprises bénéficient, comme Azura (Saveol) » sont produites dans des conditions où « les pesticides interdits chez nous se retrouvent dans nos assiettes… pourtant, depuis 5 ans aucun contrôle sur ces produits ! », dénonce Lorine Azoulai, chargée du plaidoyer souveraineté alimentaire pour le CCFD-Terre Solidaire et co-présidente du Collectif Nourrir.
Maroc, premier fournisseur agricole de la France
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Maroc est devenu le premier fournisseur agricole de la France en 2024, assurant 76% des importations françaises de tomates. Pourquoi ? Parce que la France lors du protectorat a désorganisé l’agriculture locale pour produire des tomates (notamment) pour la France hors saison. Et ce fonctionnement agricole a perduré via des accords commerciaux.
On retrouve le même système dans les territoires outre-mer où 60% de la PAC sert non pas à l’alimentation locale, mais à la culture de bananes, sucre et rhum pour l’exportation vers la France. Derrière cette domination se cachent de lourds coûts environnementaux et sociaux : l’agriculture mobilise 86% des ressources en eau du Maroc par exemple, accentuant la pression dans une région déjà en stress hydrique. L’eau est pompée dans la Méditerranée, dessalée et coûte cher donc ne bénéficie qu’aux plus riches exportateurs et non aux petits paysans locaux.
Environ 44% des pesticides utilisés ne sont même pas autorisés en Europe. La production repose sur une main-d’œuvre féminine saisonnière payée jusqu’à 14 fois moins qu’en France, souvent dans des conditions d’extrême précarité et d’exploitation sexuelle dénoncées par 88,3% des ouvrières dans certaines régions.
« Un mauvais alchimiste prend de l’or pour en faire Duplomb »
Morgan Ody, paysanne, coordinatrice générale de la Via Campesina, ne mâche pas ses mots : « se fournir ailleurs pour conserver notre mode de vie, c’est un accaparement de terres inquiétant. C’est un renouveau du colonialisme. » Ces pratiques fragmentent et fragilisent les filières françaises, malgré les discours officiels vantant la souveraineté. Le sénateur écologiste Daniel Salmon souligne une incohérence majeure : « la France sénatoriale inquiète des situations liées au COVID puis à l’Ukraine se lance dans la souveraineté alimentaire, mais comme un mauvais alchimiste prend de l’or pour en faire Duplomb ». Ainsi le sénat célèbre une souveraineté alimentaire contenue dans sa toute nouvelle loi, mais soutient en parallèle des chaînes d’importation et d’exportation qui reproduisent des déséquilibres et des injustices, « en particulier via des accords de libre-échange inadaptés. »
La récente loi d’orientation agricole de mars 2025 « pour la souveraineté alimentaire » a beau vouloir protéger la production nationale, elle soutient également les capacités exportatrices, reproduisant en creux une logique de dominance plutôt qu’une véritable autonomisation solidaire. La réalité dépasse le juridique, et les acteurs alertent sur un « double standard » inacceptable : « on interdit certains pesticides ici tout en exportant ces produits et en important des denrées cultivées avec eux ailleurs, imposant ces standards aux pays pauvres », alerte Lorine Azoulai. L’usine Syngenta fabrique par exemple à Aigues-Vives (Gard) le Primextra Gold, herbicide à base d’atrazine, perturbateur endocrinien interdit en France depuis 2003, pour l’exporter au Soudan, au Pakistan ou encore en Ukraine…
Confédération paysanne
Face à ce constat, la conférence propose des solutions concrètes, portées par le Collectif Nourrir et la Confédération paysanne : une refonte des règles commerciales internationales vers plus de justice et de gouvernance démocratique, l’orientation des aides publiques vers des transitions agroécologiques, avec un revenu stable garanti aux agriculteurs, le développement des circuits courts pour renouer avec la proximité alimentaire, et une éducation populaire pour sortir de la dépendance aux plats ultra-transformés et retrouver une alimentation saine et équilibrée.
Comme le rappelle Morgan Ody : « La souveraineté alimentaire n’est pas seulement une question nationale, c’est un enjeu mondial qui engage notre responsabilité collective. »